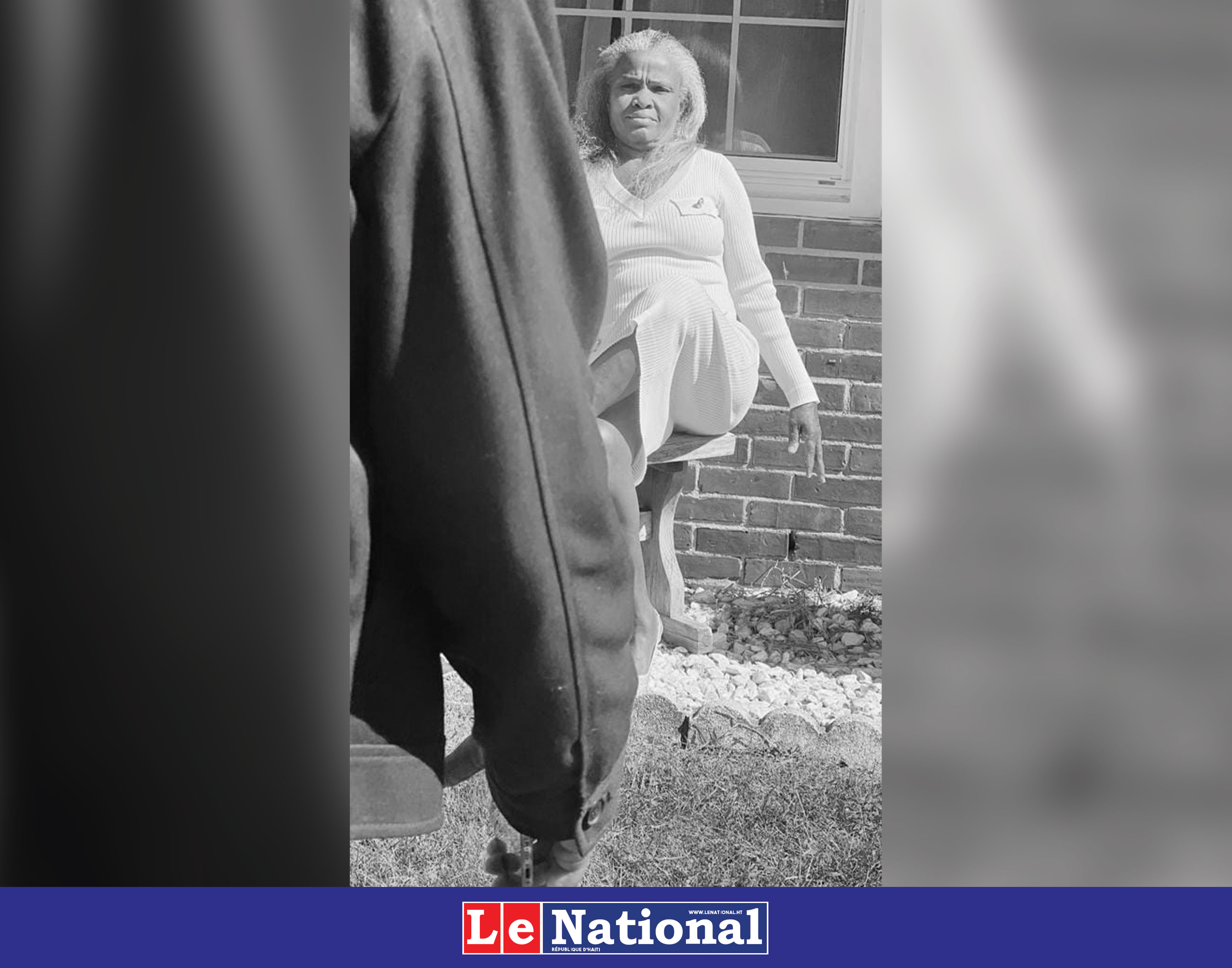La nature fait toujours très bien les choses. Le coq, grand prédateur des vers de terre, semble être conscient aussi de sa condition de proie très prisée par d’autres rapaces. Pour se protéger de ces dernières et dormir en toute quiétude, il prend logement dans les feuillages d’un arbre en comptant sur l’obscurité quasi-totale pour se camoufler et jouir du plaisir d’un bon sommeil réparateur sans perturbations et sans stress. Ces précautions, une fois prises, il s’endort sans soucis et sans crainte sans qu’il n’ait à prier pour demander aide et protection à qui de droit…
Au réveil, son premier geste sera de battre très fortement ses ailes sur lui-même comme s’il s’apprêtait à prendre son envol. L’observation a montré par la suite que c’est sa façon à lui de sortir de la léthargie dans laquelle le sommeil l’avait enfermé, se convaincre qu’il est toujours là, qu’il existe et est bien vivant ! Alors et alors seulement, en respectant le rituel inscrit dans ses gènes, il se hissera sur la pointe la plus extrême de ses pattes, et, la poitrine bien bombée, fortement projetée vers le haut, il entamera avec fierté et élégance son chant matinal, le fameux « cocorico universel » ( les coqs n’ont pas connu leur épisode de tour de Babel ☺) comme si la survie de l’espèce en dépendait et pour dire aux autres « Réveillez-vous, je suis vivant et vous ? ». Alawonbadet, tous les autres coqs du voisinage et de la basse-cour s’empresseront de répondre de manière alternée à cet appel de courtoisie et de réveil avec, bien sûr, la même vivacité même si ça et là on notera des variantes dans les timbres et des sons des uns et des autres laissant peut-être penser qu’il y en a qui n’étaient pas trop pressés de se réveiller. Suivront donc à la chaine et à intervalles réguliers des cocoricos à n’en plus finir…
L’être humain, longtemps avant la fabrication de l’horloge, se fiait au chant du coq pour moduler son cycle de réveil sur celui du fier gallinacé. Le lever du soleil n’était pas trop loin, une fois que le coq s’était mis à chanter. De nos jours encore, dans les campagnes, son chant reste la référence en matière de repère annonçant l’aurore…
Le cocorico a aussi aidé les hommes dans la communication. Des années passées, bien avant le téléphone sans fil, l’ancêtre du téléphone intelligent d’aujourd’hui, des hommes et des femmes arrachés, déracinés (les premiers déportés, à ne pas confondre avec les renvoyés d’aujourd’hui !) de leur terre natale avaient choisi de se mêler aux ombres de la nuit pour devenir invisibles et se rencontrer loin des regards indiscrets et inquisiteurs de leurs prédateurs d’alors. Au cours de ces réunions, ils discutaient de l’inacceptable et sur les voies et moyens de planifier leur sortie, leur passage d’un système inhumain féroce et barbare à un autre plus humain, plus juste et plus égalitaire. Leurs alliés d’alors ? D’abord, en plus de leur détermination à se battre pour que leurs progénitures vivent autrement, il y avait la nature elle –même, à travers l’obscurité de la nuit qui a été à la fois complice et alliée ensuite la cooptation du chant du coq pour en faire un puissant moyen de communication et de ralliement.
Le son du lambi, comme le chant du coq, était celui du ralliement qui était relayé de plaines en montagnes et de montagnes en vallées pour couvrir toutes les plantations. Il était attentivement écouté par des oreilles exercées, expertes en décodage. Grâce à ce système de communication hors pair, alliant sens de l’observation de la nature, repérage des lieux et stratégie de camouflage qu’on appellera marronnage et qui feront plus tard partie des techniques de guérilla, nos révoltés avaient jeté, par leurs actions, les bases de ce qui sera la lutte pour la reconquête de leur dignité et liberté confisquées et ravies. Longue lutte qui, depuis la cérémonie du Bois Caïman le 14 août 1791 en passant par le congrès de l’Archahaie le 18 mai 1803 pour aboutir à Vertières le 18 novembre 1803, a vu des hommes et des femmes s’offrir en holocaustes pour que leurs frères et sœurs et les générations futures puissent vivre la tête altière et regarder les autres êtres humains les yeux dans les yeux quel qu’ils soient !
Tout est dans la nature. Il avait suffi à ces marrons de la liberté d’observer ce qui se passait dans leur environnement pour en faire une arme ou un allié, d’entendre le chant du coq pour s’en inspirer, faire des miracles et étonner le monde !
Sommes-nous capables aujourd’hui, nous qui sommes les dépositaires de leur héritage, d’être à l’écoute des plaintes et des gémissements de nos frères et sœurs qui souffrent, d’entamer le chant qui nous rassemblera pour, ensemble, dans la concertation définir des stratégies qui nous permettront enfin de créer les conditions favorables à l’émancipation et l’épanouissement de l’être haïtien, être humain à part entière ?
Sommes-nous capables, en nous ressourçant dans nos valeurs fondatrices, de trouver l’énergie et le courage nécessaires pour, en ces temps d’incertitude et de confusion, accorder nos violons, nous réconcilier avec nous-mêmes pour construire la paix, véritable garante de la stabilité et de la prospérité ?
Sommes-nous capables aujourd’hui, à la veille de la commémoration de la fête du drapeau, symbole de l’unité et de notre indépendance, de nous unir autour du drapeau pour transmettre aux générations futures les valeurs de dignité, de liberté, de fierté et de bravoure qui avaient fait de nous en 1804 un peuple de Lumières ?
Quel sens doit-on donner aujourd’hui à la célébration de la fête du drapeau dans un pays qui aura connu en 30 ans 2 interventions étrangères et une autre, actuellement, en cours de préparation. Un triste record !
Mai 2024
Samuel E. Prophète
Crédit/Photo: Science et Avenir