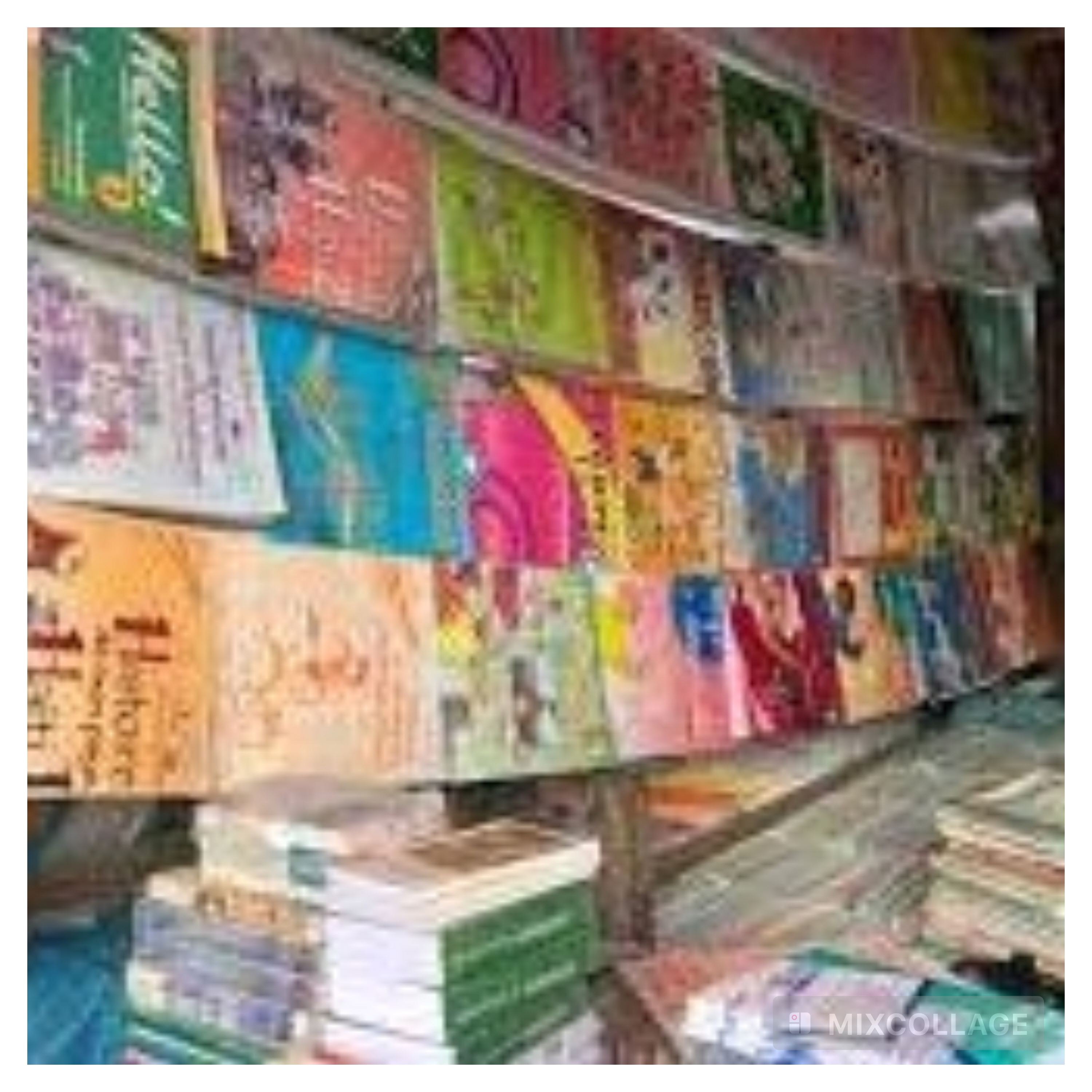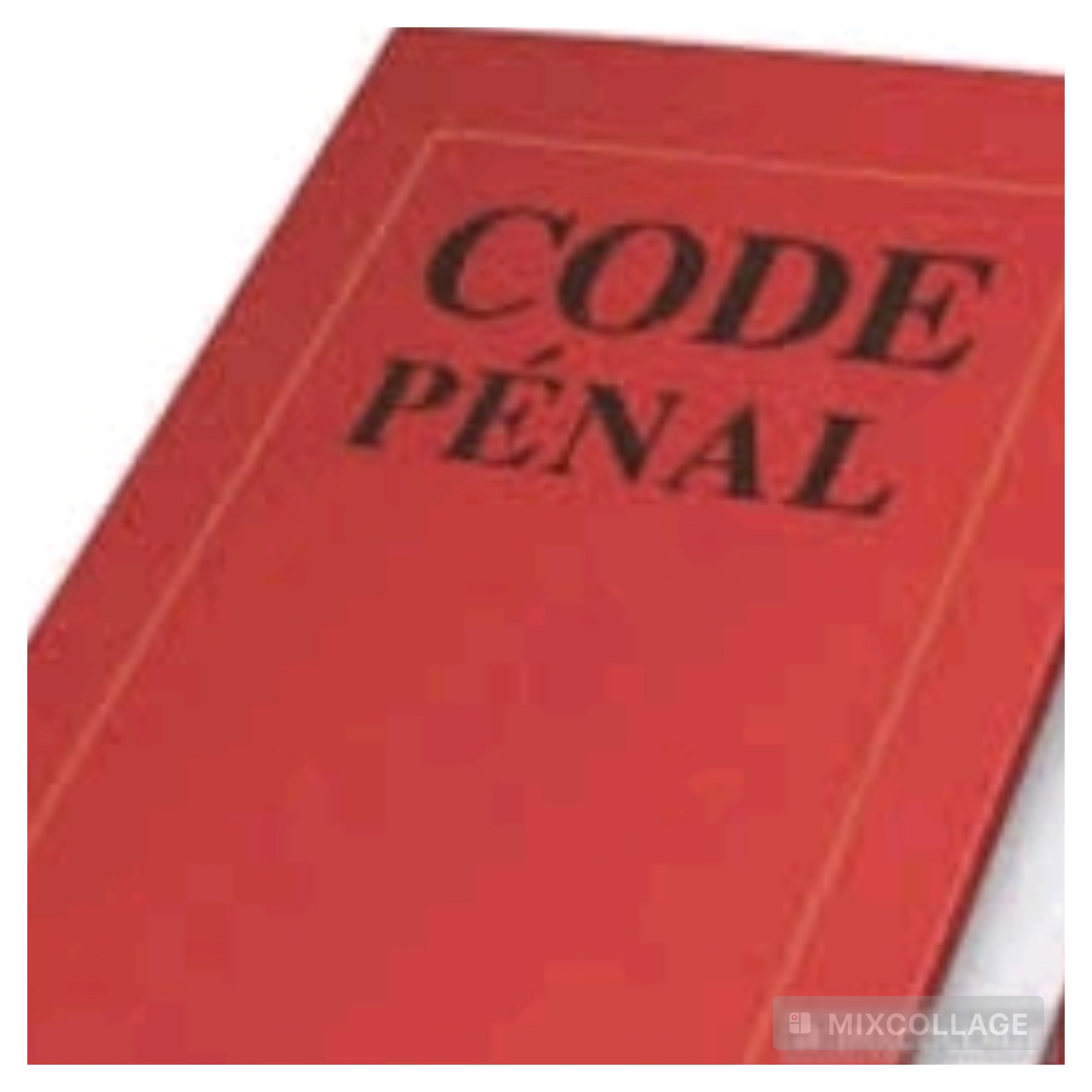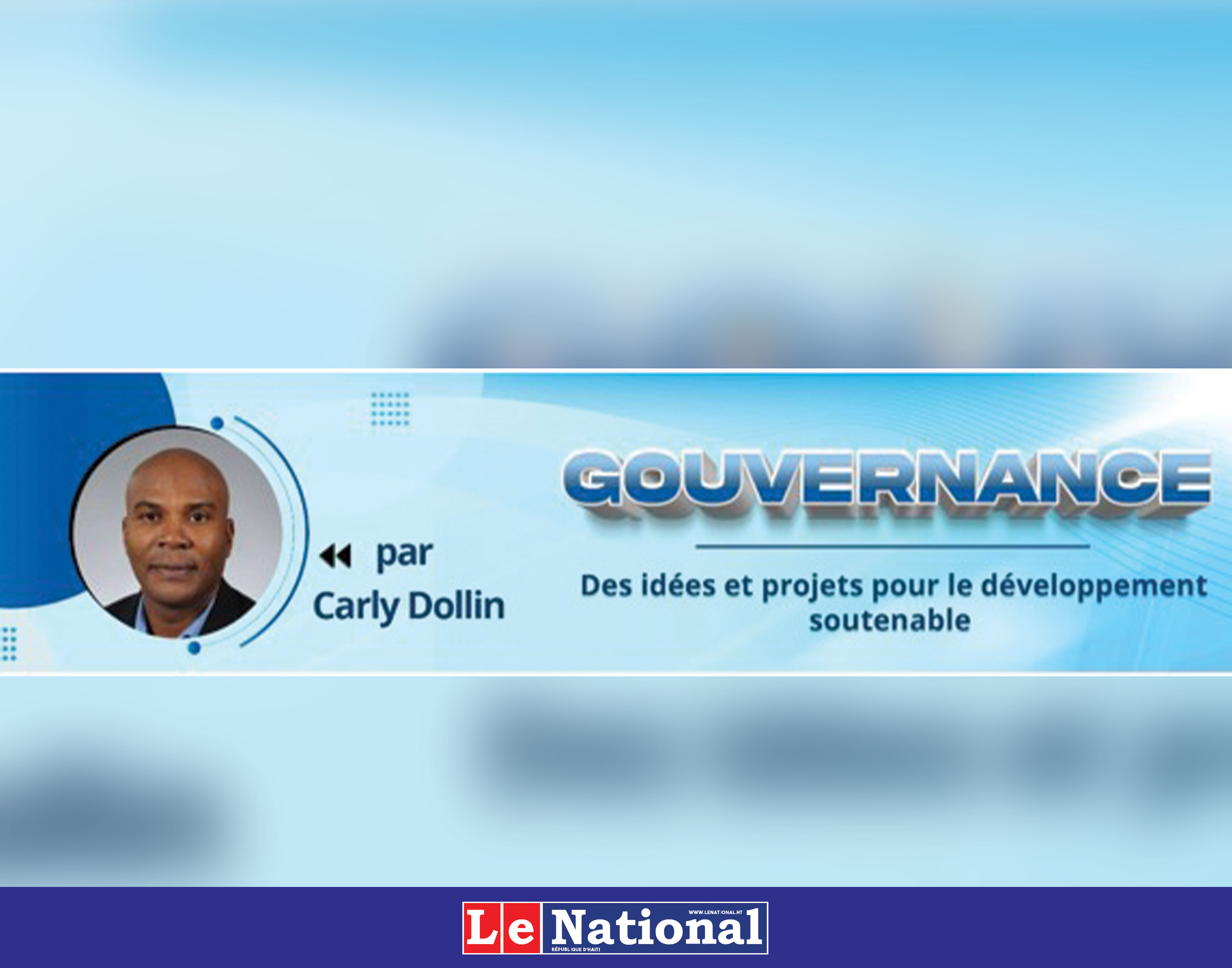Le journal Le National du 22 juin 2023 attribue au Dr Eddy Labossière les propos suivants : “Toutes les activités économiques du pays sont dysfonctionnelles: pas de production nationale, pas d’exportation, il n’y a pas d’investissements de l’étranger par rapport au climat d’insécurité et d’instabilité politique, le secteur du tourisme n’a rien rapporté de significatif à l’économie depuis quelque temps, les transferts d’argent de la diaspora vers Haïti ont de préférence baissé. C’est un pays où les variables économiques et scientifiques ne répondent pas pour expliquer sa situation ». « Parler de l’appréciation de la gourde dans un tel contexte est un mensonge! », a-t-il poursuivi.
Reliant le marché des changes à l’insécurité, l’interlocuteur de M. Oberde Charles estime que : « Les ravisseurs exigent souvent de très fortes sommes d’argent en dollar. Cela oblige les victimes à faire des retraits à la banque, et ces sommes-là n’ont pas été reconduites dans le système puisque les bandits sont incapables de dépenser correctement cet argent. En revanche, de telles situations provoquent la rareté et l’indisponibilité de cette monnaie dans l’économie. » Quand les enlèvements sont en hausse (ou en baisse) la demande de dollars serait en hausse (ou en baisse). Le Dr Labossière voit l’appréciation nominale de la gourde comme une « correction sévère et violente du marché », par des « mains invisibles » saisies par « une peur » causée par le mouvement des bwa kalé et des anticipations de représailles (ainsi que des « menaces ») de la population contre « la classe politique et l’élite économique », bref, contre « l’ensemble de ces personnes qui suscitent la montée et la rareté du dollar dans l’économie ». Après avoir rappelé les « seuls » facteurs de relèvement de l’économie et de rétablissement de la stabilité de la gourde, l’économiste conclut un peu péremptoirement qu’ « aucune théorie économique ne peut justifier la tendance de la dépréciation du dollar et l’appréciation de la gourde ».
On voit dans ces commentaires la perpétuation d’une confusion analytique sur la relation théorique et/ou empirique entre le niveau et les variations du cours de la gourde et la production. La gourde baisserait parce que Haïti ne produit –et n’exporte- rien répètent à tout bout de champ nos analystes commentateurs (ainsi que les politiciens) sans faire la liaison entre le marché monétaire et des changes et l’économie réelle. Si c’est le cas, l’inverse serait également vraie et cette appréciation reflèterait ou signalerait une augmentation de la production et des exportations. Il existe un canal implicite constamment négligé par les analystes vedettes qui conduisent malheureusement à des erreurs lamentables.
Le modèle économique de Labossière lui donne des problèmes ; peut-être s’il l’avait explicité, les résultats seraient plus clairs. On attend encore le chemin qui conduit au taux de change de G40 promis en 2021. On comprend les frustrations et l’exaspération des observateurs avisés sur l’approfondissement de la misère matérielle, morale et académique du milieu et on n’a pas de problème à partager avec le professeur Labossière le délabrement évident et persistent des fondamentaux de l’économie. Toutefois, l’appréciation nominale de la gourde ne saurait être un mensonge puisque le phénomène est public et observable par tout le monde depuis avril dernier, malgré les imperfections de l’indice conventionnel utilisé[1]. En outre, la théorie ne justifiera probablement pas la dépréciation du dollar, mais peut l’expliquer à court terme par un changement soit dans l’offre de dollars (ou de gourdes) soit dans la demande de dollars (ou de gourdes) sur le marché des changes. Le solde courant de la balance des paiements comme flux exerce une pression indiscutable sur le marché, mais ne saurait maintenir le – et assurer la croissance constante du- prix du dollar sans un ajustement du stock de dollars dans le système financier local. Des études empiriques (à la BRH, particulièrement, mais aussi dans certains centres universitaires) ont démontré depuis longtemps que la substitution de monnaie en Haïti –comme dans les autres économies dollarisées - dépend positivement de l’inflation courante ou anticipée[2]. Donc, pour un flux et un stock de dollars donnés, toutes les variations du change s’expliquent par l’offre et la demande de gourdes sur le marché des changes.
La continuation de la tendance dépendra de l’anticipation des agents et du comportement des autorités monétaires (Palais National, Primature, ministère de l’Économie et des finances et BRH) et surtout du degré de transparence accepté par les décideurs en terme de disponibilité et de fréquence de communication des données pertinentes de politique monétaire. Depuis quelque temps, en effet, la BRH est revenue sur l’effort de transparence initié en 1993 sous Bonivert Claude –renforcé en 1994-1996 avec Leslie Delatour- et pratique ouvertement la rétention des informations pertinentes, cruciales pour les agents avisés (réserves nettes de change, base monétaire désagrégée…) ou retardent délibérément leur publication. Dans un régime de parités fixes, les détenteurs de gourdes n’auraient pas autant de problèmes à utiliser leurs actifs pour les trois fonctions monétaires (unité de compte, moyen de paiements et réserve de valeur), la monnaie étant garantie. Plus de 30 ans après le changement de régime monétaire, les autorités locales pensent pouvoir émettre la monnaie non garantie a) à leur guise –d’autres diraient : à leur discrétion- an gwo ponyèt et b) sans informer le public et arrivent à trouver des économistes et des publicistes généreux pour chasser des sorcières, soupçonnées de spéculation (comme ce Premier ministre anglais des années 60 pourfendait les « gnomes de Zurich » à l’occasion des déboires de la livre sterling). Comme les anticipations reposent sur l’information, selon l’adage anglo-saxon Trust but Verify, l’absence d’information envoie un signal négatif ou pessimiste qui oriente la variable dans un sens non souhaité par l’autorité monétaire. Il n’y a certes aucun mystère dans la fabrication du cola, mais quelque part on en fait un secret.
Ces « mains invisibles » capables, selon le Dr Labossière, d’apporter une « correction violente au marché » par une surévaluation nominale de la gourde sont en train d’acheter des gourdes/vendre des dollars en cachette sous la menace de bwa kalé et, par conséquent, font l’affaire de la BRH qui en a le monopole d’émission. Prévoit-on un autre tremblement de terre qui a valu des entrées exceptionnelles de devises et une augmentation des réserves (nettes) de change à près de $3 milliards et une appréciation nominale substantielle ? Découverte de gisements de pétrole ? Autrement dit, l’effet de cette correction ne sera pas durable sans le consentement de l’émettrice unique de gourdes qui n’a absolument aucune raison de refuser la manne verte du ciel. Les dollars s’achètent en gourdes soit en monnaie fiduciaire gourdes, soit par crédit libellé en gourdes, deux agrégats contrôlés par la BRH, le premier en volume directement, le second en prix via les taux d’intérêt/réserves obligatoires. Ce sont les instruments de politique monétaire depuis l’adoption du taux de change flexible au début des années 1990. Aucune main invisible ne peut influencer le marché des changes de manière durable –encore moins le corriger- si elle ne contrôle l’offre de gourdes, un puits sans fond. Telle main invisible devrait avoir une demande illimitée de gourdes (≡une offre illimitée de dollars). Contrairement à celle d’Adam Smith, la main invisible d’Eddy Labossière ne fait pas preuve de rationalité : il y a d’autres façons moins onéreuses d’éviter les bwa kalé.
Correction au marché ? Difficile à croire à moins d’admettre que la gourde était préalablement sous-évaluée, ce que Labossière lui-même semble rejeter quand il crie au mensonge, en admettant qu’une correction suppose une réorientation plus ou moins subite de la variable vers une trajectoire tendancielle justifiée par des déterminants conventionnels. Peut-on supposer une sous-évaluation de la gourde quand l’inflation courante est supérieure au taux de dépréciation ? Quand les taux d’intérêt nominaux du système bancaire (financier) sont inférieurs au taux de dépréciation ? Quand le taux d’inflation dépasse de loin le taux d’inflation du principal partenaire économique d’Haïti ? Quand la BRH impose un black out sur les données de base de son bilan comme les réserves de change et le passif monétaire en gourdes ? Est-ce que la correction est déjà arrivée ou bien doit-on l’attendre ? Autrement dit, qu’est-ce qui se passe exactement sur le marché des changes depuis avril dernier ?
En fait seule la BRH est en mesure de répondre à la question et, comme elle ne juge pas nécessaire d’éclairer le marché pour de meilleures décisions de la part des agents, on a recours à des hypothèses, aux spéculations et surtout à l’histoire. En effet, quand le présent est trouble –et troublé- et le futur plus incertain que jamais le passé représente un guide pour l’agent soucieux de minimiser ses pertes et/ou de maximiser ses gains. Qu’est-ce qui s’est passé fin 2020 (fiscal) ? Les études sont rares : l’unique texte disponible vient d’un papier du FMI[3] qui reconnait les causes de la flambée du dollar américain avant septembre 2020, mais les néglige dans sa plongée subséquente attribuée à une action délibérée de l’autorité monétaire pour défendre la gourde. Et comment ? Bien que le financement monétaire soit réduit au minimum en octobre 2020 (illustré dans le papier, page 7), le staff du FMI explique l’appréciation par la (ré) introduction de remises sur les recettes d’exportations, l’augmentation des transferts sans contrepartie (pendant le Covid-19). Quant à la BRH qui n’a pas désapprouvé le papier du FMI on attend encore son évaluation de sa politique monétaire en 2020. Le Rapport Annuel 2018 est le dernier à paraitre sur www.BRH.ht. La Note sur la politique monétaire de la BRH du 4ème trimestre fiscal 2019-20 illustre sans aucun commentaire l’appréciation nominale de la gourde et rapporte la « stérilisation » d’« un montant de liquidité équivalant à près de G16.9 milliards » en septembre 2020 à travers des ventes (nettes) de devises totalisant US$94.5 millions en notant un ralentissement de la croissance de la base monétaire à 3.5%[4] contre 6.68% au trimestre précédent (juin 2020) des augmentations régulières de la base monétaire au cours des deux trimestres.
Quelle est la leçon ? Fin 2020, la BRH a retiré de la circulation une quantité non négligeable de monnaie indésirable causant une rareté relative de gourdes et l’augmentation du prix de la monnaie nationale en utilisant une bonne partie des réserves de change[5]. Comme la planche à billets n’a pas cessé de fonctionner, la monnaie BRH a repris sa vigueur au premier trimestre fiscal 2021 apportant la « correction » nécessaire au taux de change dès novembre 2020. Faute de données contemporaines sur les réserves de change et sur lla base monétaire, il est raisonnable de supposer que l’appréciation nominale courante (2023) résulte : (a) d’une baisse de la demande de devises (@ offre de gourdes) au passif de la BRH (b) causée, à l’actif, soit par une utilisation de réserves soit par une réduction des avoirs intérieurs (financement public[6] et/ou privé).
Bien que notre société soit fétichiste et notre économie rachitique, l’homo economicus haïtien sait comment minimiser les risques quand il/elle ne peut pas maximiser ses gains. Une détentrice de dollars qui gagne un revenu annuel au-dessus du seuil de pauvreté devrait-il vendre maintenant ou dans trois mois ? Un détenteur de gourdes dans la même catégorie de revenus, en quête de dollars, devrait-t-il acheter maintenant ou dans trois mois ? Est-ce qu’on a besoin ou pas de protection pour ses économies en gourdes ou pour ses économies en dollars ? Est-ce qu’il faut emprunter en dollars pour acheter des gourdes ou vice versa ? Voilà le genre d’incertitudes dans lesquelles une politique monétaire incohérente et opaque jette les agents économiques, consommateurs comme épargnants, employeurs comme employés, importateurs comme exportateurs, banquiers, financiers comme investisseurs, tous deviennent des « spéculateurs », des « mains invisibles », pour répéter le Professeur, obsédés par le court terme et anxieux de protéger la valeur de leur patrimoine durement acquis. Souvent, et très souvent même, comme M. Jourdain, ils/elles pratiquent la spéculation sans le savoir, par exemple, en refusant de vendre leurs actifs en dollars aujourd’hui ou en précipitant leurs achats de gourdes et en gourdes. Est-ce un crime de faire un emprunt en gourdes à 20% pour acheter des dollars qui vont me rapporter 30% en gourdes dans un an ? L’autorité monétaire ne devrait-elle pas comprendre que des ajustements sont nécessaires dans l’offre de gourdes autrement les « mains invisibles » feront l’arbitrage ? La spéculation atteint une dimension meurtrière et criminelle quand, épousant les contours de la société, elle exploiterait des informations ou des positions privilégiées à des fins personnelles…
On n’en serait pas là si, dans l’esprit qui avait conduit à la création de l’Association Professionnelle des Banques (APB), devenue particulièrement timide, et à la Commission Paritaire APB/BRH à la fin des années 80, la politique monétaire construisait et renforçait sa crédibilité dans la transparence et la concertation avec le secteur privé, avec les intermédiaires bancaires dans une première phase et avec les banques d’investissements dans une seconde phase. La plupart des économistes et des analystes économiques honnêtes –Eddy Labossière compris- aimeraient certainement donner une réponse satisfaisante aux questions angoissantes des agents relatives à cette appréciation nominale de la gourde. Malheureusement, seule la BRH connait le secret. En attendant le passé est et demeure -tout aussi malheureusement- l’unique guide. Comme dans la fabrication de boissons gazeuses, il n’y a pas de mystère dans la politique monétaire, seulement des secrets…
Henry Robert Dubois
@hrdubois
Notes
[1] Le taux de référence de la BRH est une moyenne pondérée des taux moyens du secteur formel et des taux moyens du marché informel. C’est une construction statistique imparfaite sujette à des altérations qui affectent ses propriétés analytiques comme les ententes de la BRH avec les banques.
2 Et, si la substitution est interdite dans l’économie formelle, à des sorties de capitaux ou à des acquisitions improductives de bijoux ou d’œuvres d’art ou enfin aux placements liquides sous le matelas
3 « Lessons fron Haiti’s Recent Exchange Rate Developments »WP/22/225 de Novembre 2022 par Rina Bhattacharya et Neil Shenai. Les propositions et les conclusions de ce papier devraient faire l’objet d’un débat sérieux.
4 La Note du 1er trimestre 2020-21 donne un taux (corrigé ?) de 2.8% pour septembre 2020.
5 Les observateurs avisés noteront que la BRH a choisi –mais n’était pas obligée- d’utiliser les réserves de change pour maitriser son passif monétaire.
6 Que l’augmentation récente des recettes (et des dépôts) de l’Etat rendrait plausible si –et seulement si- les dépenses n’augmentaient pas proportionnellement.
[1] Le taux de référence de la BRH est une moyenne pondérée des taux moyens du secteur formel et des taux moyens du marché informel. C’est une construction statistique imparfaite sujette à des altérations qui affectent ses propriétés analytiques comme les ententes de la BRH avec les banques.
[2] Et, si la substitution est interdite dans l’économie formelle, à des sorties de capitaux ou à des acquisitions improductives de bijoux ou d’œuvres d’art ou enfin aux placements liquides sous le matelas
[4] La Note du 1er trimestre 2020-21 donne un taux (corrigé ?) de 2.8% pour septembre 2020.
[5] Les observateurs avisés noteront que la BRH a choisi –mais n’était pas obligée- d’utiliser les réserves de change pour maitriser son passif monétaire.
[6] Que l’augmentation récente des recettes (et des dépôts) de l’Etat rendrait plausible si –et seulement si- les dépenses n’augmentaient pas proportionnellement.