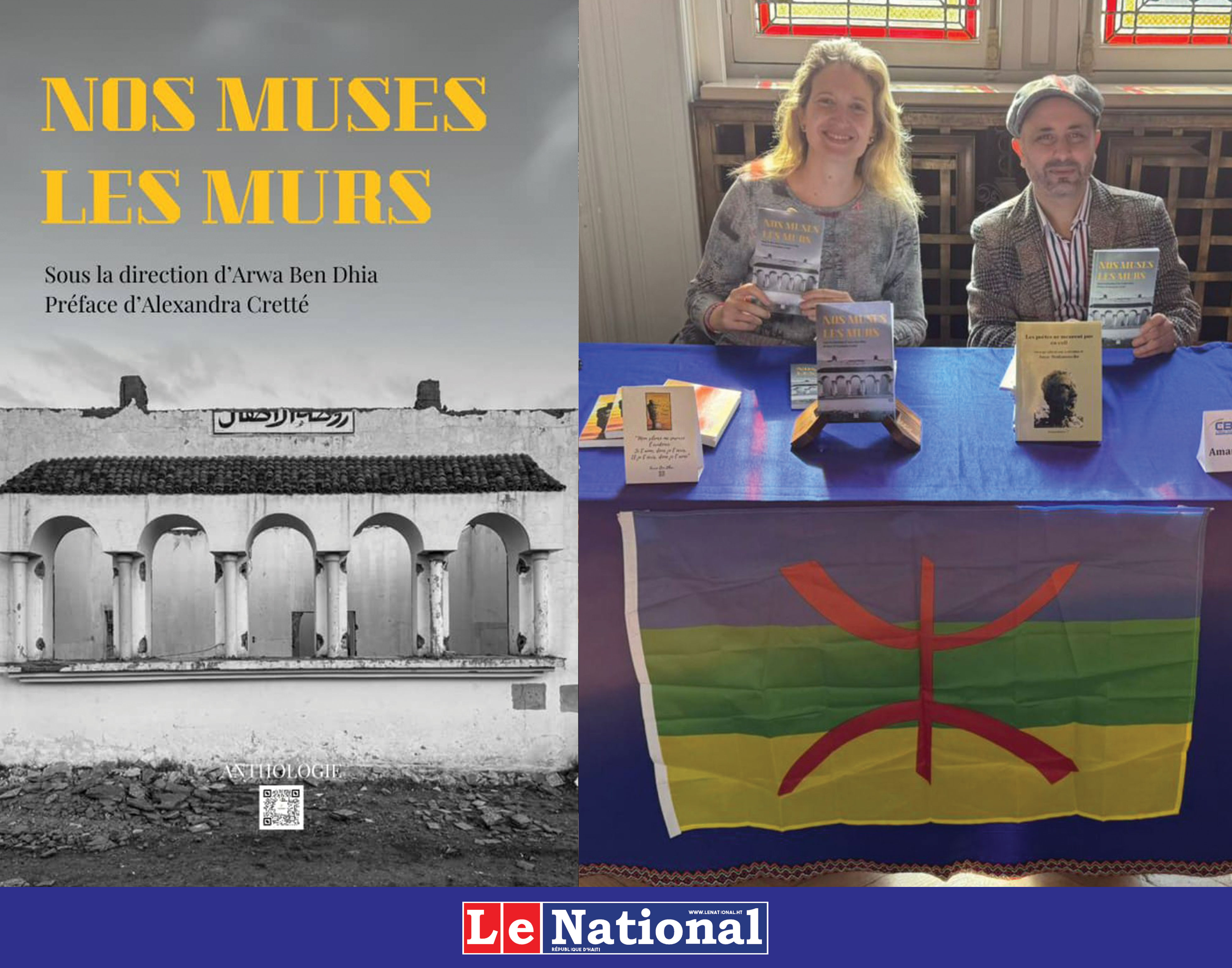Samedi soir, dès dix-neuf heures trente, une certaine fébrilité flottait dans l’air. Autour de l’église de Grolay, dans le département du Val-d’Oise, les pas s’accéléraient, les voix se cherchaient, les regards se croisaient. Quelque chose d’invisible, d’intense, circulait entre les murs et les âmes : la promesse d’un rendez-vous avec la mémoire.
C’était le grand jour. Voilà plus de trois ans que ce projet attendait sa naissance sur la table de l’avocat et dramaturge Éric Sauray. Trois années de labeur discret, de doutes et d’espérances, à modeler et remodeler les mots, à chercher le ton juste celui qui rend justice sans emphase, celui qui élève sans trahir. Il a fallu couper, reprendre, polir, négocier avec les ombres du passé, travailler dans le silence patient où naissent les grandes œuvres. Puis vint le choix du lieu. Il ne pouvait être anodin. Tout devait être signe, tout devait parler. Et c’est une église qui fut retenue — non par hasard, mais par évidence. Car il ne s’agissait pas d’un simple spectacle, ni d’une conférence historique : c’était une cérémonie mortuaire, une liturgie du souvenir, où l’histoire d’une femme s’élèverait, enfin, à la hauteur du sacré. Ce soir-là, l’Éloge funèbre de Marie-Claire Heureuse allait être prononcé. Sous ces voûtes anciennes, le nom d’une héroïne longtemps oubliée s’apprêtait à résonner. Et dans le silence des bancs, on sentait déjà que quelque chose allait se rallumer : la mémoire s’apprêtait à reprendre voix.
Sous le ciel paisible de Grolay, l’église s’était faite sanctuaire d’histoire. Les cloches battaient au rythme d’un cœur lointain : celui d’Haïti. Des voix, des visages, des âmes — compatriotes et amis de la mémoire — s’étaient rassemblés, non pour pleurer une mort, mais pour ranimer une flamme : celle de Marie-Claire Heureuse Félicité Bonheur Dessalines, femme d’humanité, femme de lumière, épouse du premier Empereur d’Haïti, mais surtout mère silencieuse d’une nation en marche.
Dans la nef, Maître Éric Sauray, dramaturge et gardien des mémoires, prit la parole. Sa voix, à la fois ferme et caressante, traversa le temps comme une barque sur l’océan de l’oubli. De ses mots s’élevaient des fragments d’histoire — éclats de vérité, éclats de dignité — rappelant que même sous les décombres du silence, la mémoire respire.
Haïti, cette flamme qui vacille
Malgré vents et marées, malgré la mer qui sépare et les siècles qui effacent, Haïti demeure une flamme qui vacille sans jamais s’éteindre. Et dans cette lumière tremblante, chacun pouvait reconnaître une part de soi : un rêve, une blessure, un héritage. Car l’histoire d’un peuple n’est pas un livre fermé — c’est une pulsation, un souffle, un chant que les vivants doivent reprendre.
Avec Éric Sauray, les pages de notre passé ne se feuillettent pas, elles se jouent. Sous sa plume, le théâtre devient temple : un lieu où les ancêtres s’avancent à pas lents, où les héros se redressent, où la vérité se dit sans armure. Le théâtre — cet espace populaire, ce miroir brûlant — devient la scène où les morts parlent à nouveau, et où les vivants apprennent à écouter.
Marie-Claire Heureuse, dans sa simplicité et sa grandeur, y renaît non comme une icône figée, mais comme une femme debout au milieu de la tourmente, offrant des soins, des mots, des gestes de paix à ceux que la guerre déchirait. Sa vie fut un acte de tendresse dans un monde de feu. Elle fut une lampe dans la nuit de la haine, un baume sur les plaies de l’histoire.
L’acteur, dans un souffle de vérité, a su rappeler avec une justesse bouleversante combien Marie-Claire Heureuse fut une femme de dignité, de courage et de lumière. Elle n’a pas seulement traversé l’Histoire : elle l’a façonnée, et ce, du côté le plus noble des choses. Dans l’ombre du pouvoir, elle fut souvent la main douce qui retenait le bras du tonnerre, celle qui, par sa parole calme, désarmait la colère et réorientait la justice.
À plusieurs reprises, elle sut apaiser la main séculière de son époux, l’Empereur Dessalines, cet homme de grandeur et de fureur, de clairvoyance et d’excès. Lui, que l’Histoire retient comme un stratège redoutable, un fondateur et parfois un homme de fer, trouvait en elle la source tranquille où sa violence venait s’éteindre. Ainsi, au cœur même de la tourmente, Marie-Claire Heureuse fut la conscience du pouvoir, la voix du pardon dans un monde en quête de justice. Elle intervenait non pour régner, mais pour rappeler à l’humain ce que la vengeance tente d’effacer. Et dans ce geste répété, discret mais immense, se loge toute la beauté de son héritage : une femme qui ne régnait pas, mais qui, par sa bonté, gouvernait les cœurs
Le miroir de nos manquements
Cependant, il ne faut pas perdre de vue qu’à travers cet Éloge, le juriste ne se contente pas de célébrer, il dénonce. Sous la ferveur des mots, il tacle avec élégance nos turpitudes historiques, ces dérives que nous traînons de génération en génération comme un fardeau invisible. Son discours, tout en douceur apparente, porte la morsure de la vérité : celle de nos régimes politiques inefficaces, de nos gouvernants oublieux, de nos élites trop souvent complices de l’oubli
Par la comparaison subtile avec la France, Éric Sauray ne flatte pas : il éclaire par contraste. Il rappelle que la grandeur d’une nation ne réside pas seulement dans ses révolutions, mais dans la fidélité qu’elle accorde à sa propre mémoire. Ainsi, à travers le destin de Marie-Claire Heureuse, c’est le miroir de nos manquements qu’il tend à notre conscience collective.
Car comment prétendre bâtir l’avenir, si nos héros demeurent ensevelis sous la poussière de l’indifférence ? Comment parler de liberté, quand le pays oublie ses mères fondatrices dans les méandres d’un pouvoir sans vision ? En vérité, derrière chaque phrase de cet Éloge, se dresse une critique lucide et nécessaire. Célébrer nos héroïnes, ce n’est pas un geste du passé : c’est un acte de reconstruction morale et nationale.
Avant de clore cette cérémonie de mémoire, il convient d’écouter la voix même de celui qui en a été l’artisan. Dans son nouvel ouvrage, Éric Sauray poursuit la même quête : comprendre, dire, et réparer par la parole. Chez lui, l’histoire n’est jamais figée : elle se vit, se questionne, s’interprète. Ses mots prolongent ceux prononcés à Grolay : ils portent la conviction que la mémoire n’a de valeur que si elle éclaire notre présent.
Comme il l’écrit si justement, nos frères de France ont peut-être été étonnés de nous voir changer si souvent de régime politique, oubliant qu’eux-mêmes, à la même époque, avaient connu une succession de républiques, d’empires et de monarchies. En réalité, nous n’avons fait que suivre leur exemple, mais sans obtenir les mêmes résultats. L’auteur reconnaît la responsabilité des élites nationales dans cet échec et conclut que, face aux revers de la République, l’Empire n’était peut-être pas le véritable mal.
Rigueur du juriste, sensibilité du poète
Cette citation , à elle seule, résume toute la démarche de l’auteur : unir la rigueur du juriste à la sensibilité du poète, pour redonner sens à la justice, à la mémoire et à la dignité. Dans ses pages, comme dans sa voix ce soir-là, Haïti n’est plus une douleur : elle devient un devoir.
Ce samedi soir, puis ce dimanche après-midi, la veuve la plus célèbre d’Haïti a enfin reçu les hommages que l’Histoire lui devait. Les mots d’Éric Sauray se sont faits offrande, réparation, reconnaissance. Et sous les voûtes de Grolay, Haïti a respiré à nouveau, non pas dans la douleur, mais dans la mémoire partagée.
Dans chaque syllabe prononcée, on entendait un murmure : N’oubliez pas. N’oubliez jamais.
Et l’église, alors, semblait voguer — non plus sur les rives parisiennes — mais sur les eaux bleues du Cap, vers le soleil d’une île qui n’a jamais cessé de rêver de justice et de liberté. Comme souvent chez Éric Sauray, l’hommage devient question. Il ne parle pas seulement pour célébrer : il interroge, il invite, il réveille. Car dans sa voix, douce mais ferme, plane cette évidence : un peuple qui oublie ses héroïnes s’ampute d’une part de son âme.
Ce soir-là, à Grolay, l’âme d’Haïti a trouvé asile. Entre les cierges et les mots, entre les silences et les applaudissements, Marie-Claire Heureuse a repris sa place dans la lumière de l’Histoire. Et chacun, en quittant l’église, emportait avec lui un peu de cette clarté une braise d’espérance, une promesse de mémoire, une invitation à ne plus jamais laisser le néant parler à notre place.
Maguet Delva