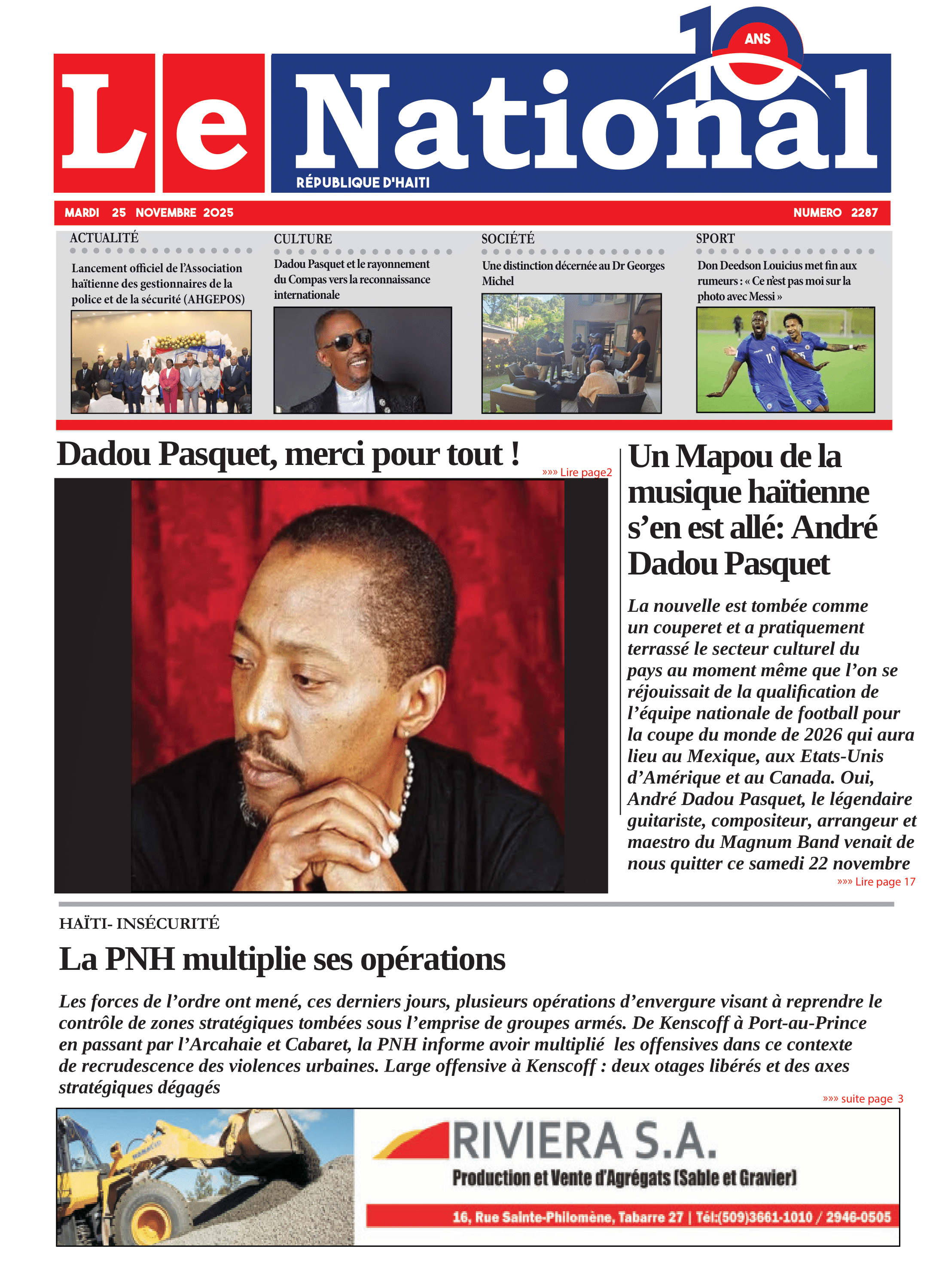Le président américain Donald Trump n’a pas tardé à réagir à la qualification historique de l’équipe haïtienne pour la Coupe du monde 2026. Depuis longtemps déjà, la question haïtienne semble exercer sur lui une fascination sombre, comme une ombre qu’il croit voir partout. Comme un tambour lointain qu’il voudrait faire taire.
Dans l’arène politique, Trump avance souvent tel un ouragan imprévisible, et lorsqu’il s’agit d’Haïti, ses positions prennent la forme d’un vent glacial. L’homme à la chevelure dorée
toujours prêt à transformer un simple courant d’air en tornade semble nourrir une méfiance instinctive envers tout ce qui touche à la nation haïtienne. Une méfiance presque mécanique,
comme si Haïti représentait pour lui un miroir qu’il refuse de regarder.
Ainsi, l’idée d’exclure les supporteurs haïtiens de la Coupe du monde devient soudain, dans son esprit, une affaire de première importance, comme si la présence d’Haïtiens sur le sol américain était un échiquier où chaque pion devait être repoussé à la frontière. Dans son univers politique, les frontières ne sont pas des lignes : ce sont des murs qu’il veut dresser dans les têtes et dans les cœurs. Et puis il y a cette manière singulière d’habiter la Maison-Blanche : détruire une aile historique pour en faire une salle de bal, comme un enfant capricieux qui transforme un musée en terrain de jeu ; dépenser des millions pour rénover des toilettes, comme si l’ego exigeait son propre trône.
Trump gouverne parfois comme on manipule un miroir déformant : tout ce qui le reflète devient grandiose, tout ce qui le contredit devient minuscule. Dans cette logique, Haïti apparaît comme un caillou dans sa chaussure, un nom qu’il prononce avec la crispation d’un homme qui croit qu’un pays entier est un désordre à ranger.
La qualification de la sélection haïtienne, fierté d’un peuple, victoire d’une diaspora, vient donc bousculer son univers politique comme un tambour qui refuse de se taire. Et voici qu’Haïti, aujourd’hui, présente au menu du monde, tout ce que Donald Trump semble ne pas comprendre, ou ne pas vouloir comprendre. Un pays sans richesse matérielle, et lui, l’homme aux cheveux jaunes, qu’on décrit souvent comme amoureux du scintillement, semble ne voir dans la misère que le bruit d’une pluie inutile.
Certains observateurs disent qu’il s’adoucit devant les rois couverts d’or et se durcit devant les peuples qui n’ont que leur dignité. C’est une lecture, une perception, une psychologie politique mais elle revient comme un refrain dans l’opinion publique.
On l’a vu rayonner devant le roi d’Arabie Saoudite, comme si la magnificence l’enveloppait soudain d’humanité. On l’a vu s’emporter, parfois brutalement, devant des journalistes qui ne faisaient que poser des questions.
La différence de ton, de respect, d’écoute, semble souvent s’aligner sur le poids des fortunes. Aux yeux de nombreux analystes, Trump distribue les égards en proportion de la brillance des portefeuilles. Alors, peut-être est-ce pour cela que le simple nom d’Haïti déclenche chez lui
une tempête intérieure. Peut-être que, dans une sorte de dramaturgie politique, nous devenons ses épouvantails : des figures qu’il préfère repousser plutôt que regarder en face.
Malgré les silences et les tempêtes
Dans cette lecture critique, le bonheur du peuple haïtien devient son chagrin, comme si notre joie sonnait faux dans son baromètre d’exclusion. L’idée même que des Haïtiens puissent réaliser un exploit, encore moins un exploit footballistique, semble entrer en collision avec son architecture mentale. Lui si prompt à réagir sur les réseaux sociaux n’a pas dit un mot. Et ce silence, pour beaucoup, devient un message. J’ai même craint un instant qu’il pousserait la logique jusqu’à vouloir empêcher l’équipe gagnante de jouer aux États-Unis. Car dans la psychologie qu’on lui prête, l’équipe haïtienne ne devrait jouer devant personne, encore moins devant un public haïtien capable de transformer un stade entier en océan de bleu et rouge.
Dans cette mécanique, tout ce qui concerne notre peuple devient exclusion, sévérité, discrimination perçue. C’est un schéma, un refrain, une habitude. Une pluie qui tombe encore et encore sur un pays déjà noyé dans la souffrance. Pourtant, malgré les murs, les silences, les tempêtes, Haïti danse. Haïti triomphe. Haïti respire. Et rien, ni exclusion ni mépris, ne pourra étouffer le tambour qui porte aujourd’hui le nom des Grenadiers.
Au fond, beaucoup d’observateurs en viennent à penser que si Donald Trump regarde Haïti avec tant de dureté, c’est parce que notre peuple n’entre pas dans son alphabet du prestige. Dans l’univers mental qu’on lui attribue souvent, la richesse est un passeport, un certificat de respectabilité, un sésame pour l’humanité.
Le reste tout ce qui n’est pas doré, tout ce qui ne brille pas prend des allures, à ses yeux, de menace, de potentiel délinquant, comme si la pauvreté était une faute morale et non le résultat d’une histoire tragique.
C’est ainsi, disent ses critiques, que fonctionne le cerveau de l’homme aux cheveux jaunis :
un cerveau qui range les êtres humains comme des marchandises en rayons, les fortunes en haut, les misères en bas. Une pensée simplificatrice, presque mécanique, où l’argent sépare les innocents des coupables et où Haïti, dans cette classification cruelle, se retrouve reléguée à la marge, dans ce couloir sombre où il place tout ce qu’il ne veut pas comprendre.
Et peut-être est-ce là, précisément, la racine de cette hostilité qu’on lit dans ses gestes : non pas une haine rationnelle, mais une incapacité profonde à concevoir que la valeur d’un peuple ne se mesure pas au poids de son trésor, mais à la force de son courage.
Maguet Delva, Paris