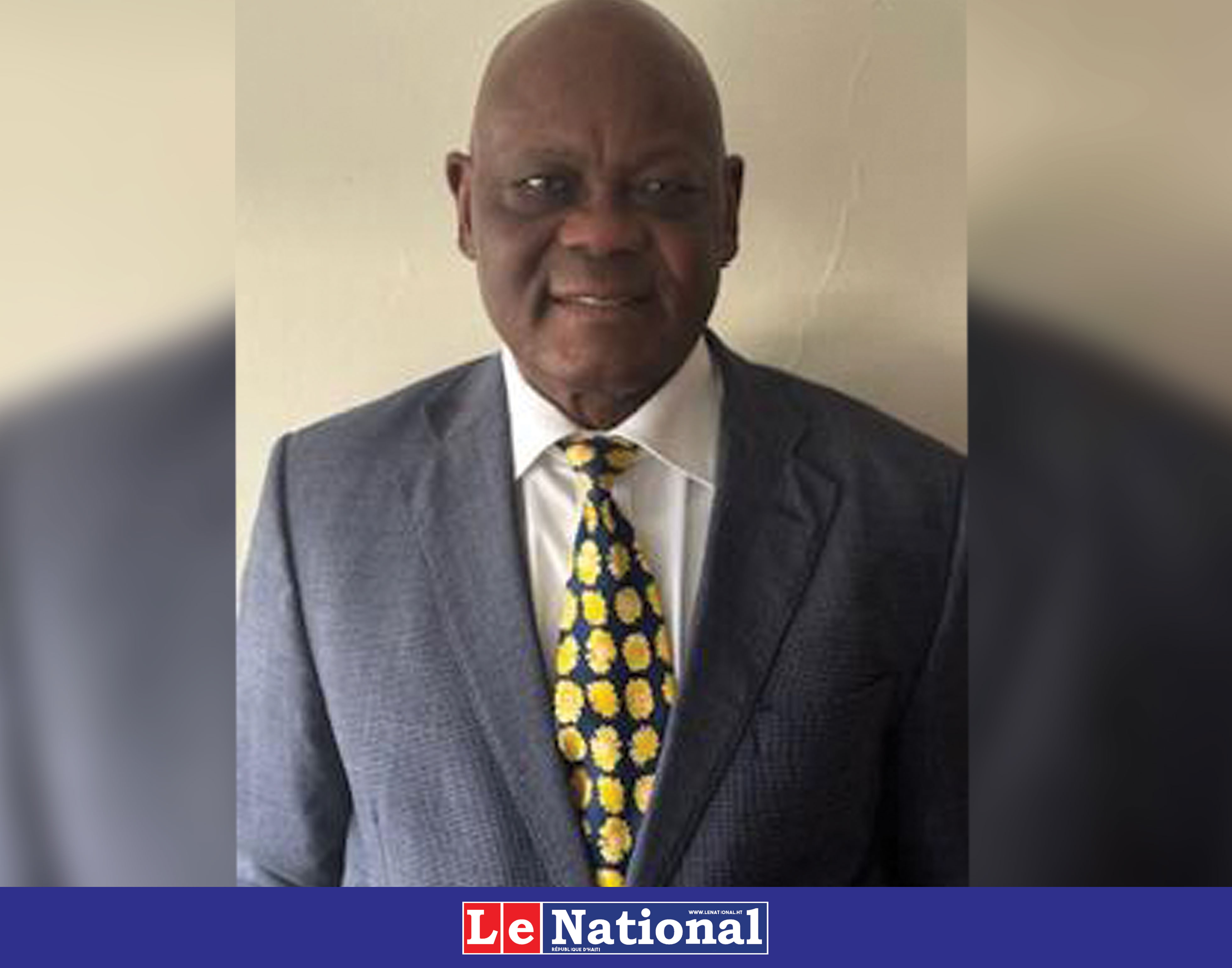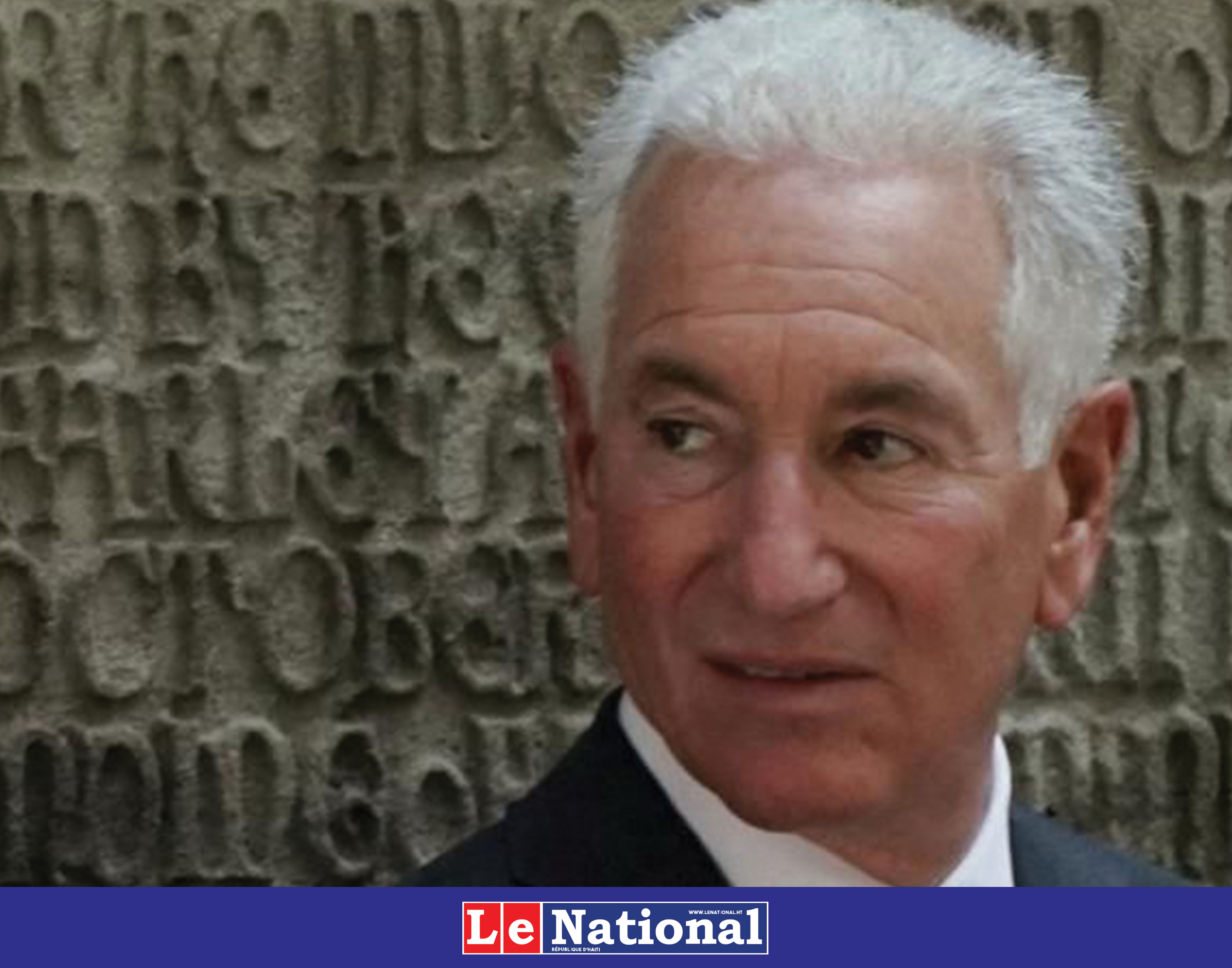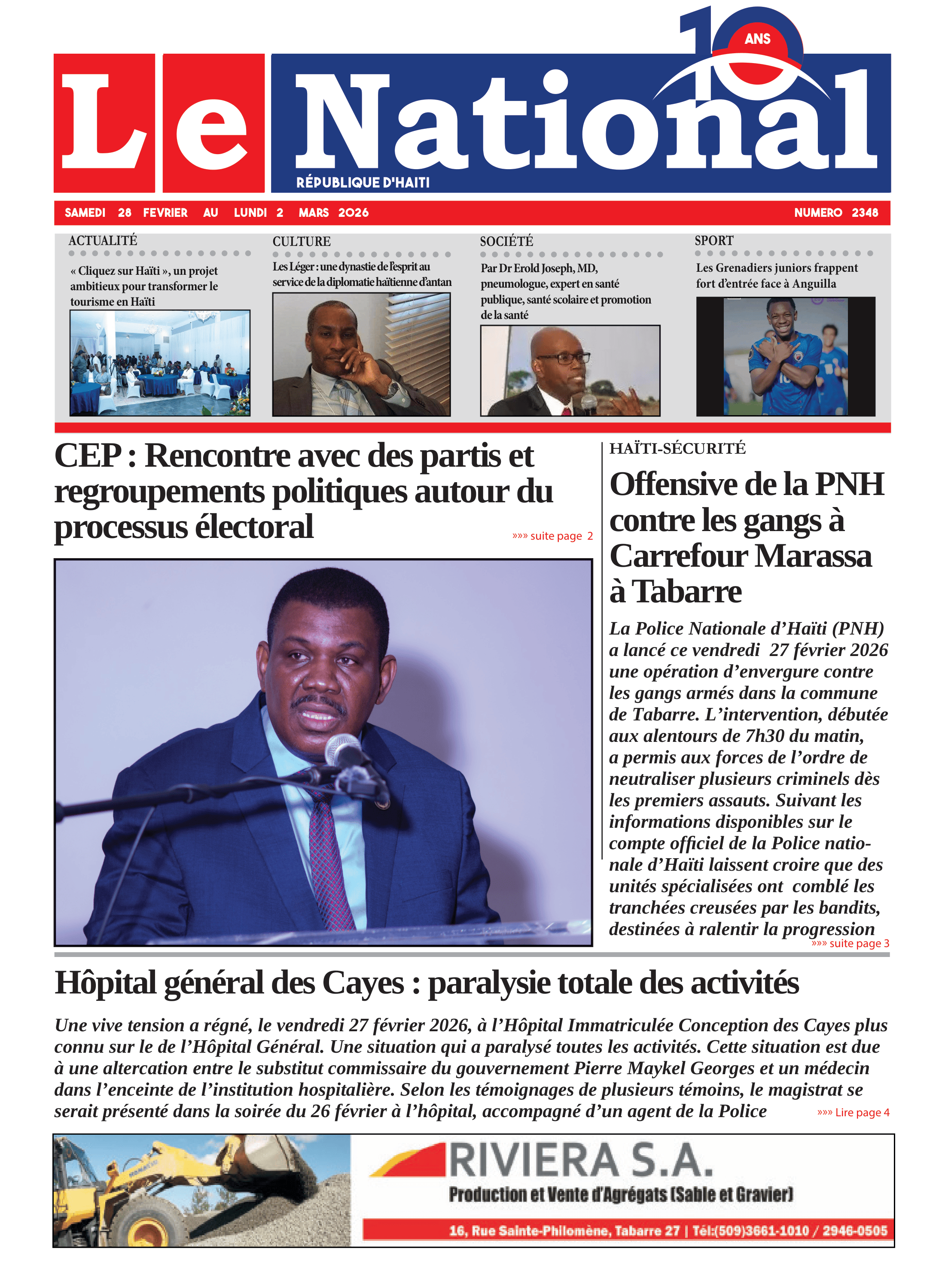Depuis longtemps des idées contradictoires ne cessent d’émettre sur le rapport existant entre la migration et le développement. Trois paradigmes marquent le débat sur cette question. Entre 1950 et 1960, le paradigme optimiste développementaliste était dominant. Pour les tenants de ce paradigme, la migration a un impact positif sur le développement, pour les pays émetteurs surtout. Ils affirment que les migrants apportent de l'argent, des idées et nouvelles connaissances et développent des comportements d’entrepreneurs. Donc, cela est bénéfique pour les pays émetteurs. En ce sens, différentes théories expliquent en quoi la migration a un fondement positif. Par contre de 1970 à 1980, le paradigme pessimiste néo-marxiste dominait les débats pendant cette période. Les pessimistes expliquent que la migration est un facteur de progression des disparités spatiales, entre les niveaux de développement (pays émetteurs et récepteurs), mais non un facteur tendant à réduire les disparités. Elle ne favorise pas le développement des pays émetteurs, mais elle est plutôt profitable aux pays récepteurs. Ces idées trouvent aussi leurs explications à travers des théories. Enfin, dans les années 1990 on assiste à une tendance dite pluraliste et avec des idées plus nuancées que les deux premières. Les porteurs de cette tendance, se basant sur des travaux empiriques, montrent que la migration a des impacts tantôt positifs, tantôt négatifs et non déterministe sur le développement.[i]
Haïti est un pays qui connaît un flux migratoire presque continue, d’une période à l’autre. Le pays a d’ailleurs une histoire avec la migration. Ce phénomène remonte jusqu’aux périodes coloniales.[ii] Par conséquent, les débats sur la migration et le développement paraissent être très évidents dans la société haïtienne. Certains postulent que les meilleures compétences du pays sont dans la diaspora. Cela peut-être une prétention. D’autres expliquent que la diaspora haïtienne est une importante contributrice de l’économie haïtienne. Partant avec ces deux affirmations, les migrants haïtiens (la diaspora haïtienne) pourraient être considérés comme des ressources pour le pays. Considérés comme étant des ressources, il est recherché comment les migrants peuvent s’impliquer réellement dans le processus de développement de leurs communautés. C’est donc la logique de cette réflexion.
Entre les trois paradigmes qui traversent les débats sur la migration et le développement, nous avons inscrit notre démarche dans celui des optimistes. Néanmoins, à travers la réflexion, nous n’endossons pas toutes les charges théoriques que charrie ce paradigme. L’aspect qui nous intéresse le plus dans ce paradigme est l’apport de l’argent par des migrants qui est brandi par les optimistes. Toutefois les migrants haïtiens (la diaspora haïtienne) apportent réellement de l’argent dans le pays, est-ce qu’un mouvement organisé dans la diaspora haïtienne ne peut pas rendre disponibles ces argents au bénéfice du développement local, en guise de seulement verser des argents dans les caisses noires de l’État central alors que ces argents ne sont pas investis dans le développement, de seulement financer la consommation (alimentaire ou autres) des ménages haïtiens, ce qui n’est pas durable ? En d’autres mots, comment peut-on rendre plus utile la diaspora haïtienne, en faisant institutionnaliser le fond de la diaspora haïtienne au bénéfice des communautés locales ?
Fort de cette préoccupation, nous avons dégagé quelques idées dans l’objectif de promouvoir l’organisation de la diaspora haïtienne, au service du développement local.
Organiser la diaspora haïtienne en communautés locales
En vue de ne pas rester, disperser dans la diaspora, ce qui ne profite pas aux migrants haïtiens, cela nécessite le développement d'une conscience de groupe. Cette conscience peut être développée à travers des rapports de proximité, ce qui peut impliquer la notion de groupe d’appartenance. À cette cause, les rapports de proximité serviront la baguette de ralliement des migrants haïtiens partout où ils se trouvent dans le monde. C’est que la proximité instituera le groupe d’appartenance qui à son tour jouera le rôle de ciment et lie les migrants entre eux. Dans la variété des éléments auxquels identifient les individus et qui naissent le groupe d’appartenance, les origines locales (lieu de naissance) des migrants, en dehors des espaces géographiques auxquels ils évoluent pour l’instant, dans cette démarche, sont primés sur les autres éléments comme les croyances, idéologies, etc. Donc sur la base d’appartenance au groupe local, des communautés locales haïtiennes pourront naître et organiser dans la diaspora haïtienne. Car, les originaires des différentes communes haïtiennes vont se regrouper dans leurs communautés d’appartenance, ailleurs étant. Par ce mécanisme, seront créées autant de communautés locales dans la diaspora haïtienne que de communes haïtiennes.
En effet, les originaires des différentes communes haïtiennes s’assembleront autour d’un représentant pour former des communautés locales de la diaspora. C’est ainsi qu’on arrivera à la parité entre les communes haïtiennes et les représentants des communautés locales dans chaque pays où se trouvent des migrants haïtiens. Ces représentants doivent être le fruit d’un congrès qui est organisé dans ces pays. Toutefois, dans tous les pays du monde où vivent des Haïtiens, se trouvera un représentant pour chacune des communes haïtiennes, il est possible d’arriver à cent quarante-deux (142) représentants par pays pour cent quarante-deux (142) communes. Les activités de ces représentants seront coordonnées par un représentant de bureau de pays. Donc, chaque pays aura un coordonnateur. Ainsi dire, dans chaque pays dans le monde où se trouvent des migrants haïtiens, ils se regrouperont autour de leur communauté, à travers un réseau bien coordonné.
Dans ce même élan de rapprochement, l’ensemble des communautés locales organisées dans la diaspora haïtienne vont être se fédérées, par le biais des représentants de pays, afin de donner un état d’équilibre et de régulation aux différentes communautés locales créées. Le siège de la fédération des communautés locales peut ainsi implanter dans n’importe quel pays où évoluent des migrants haïtiens, suivant les lois régissant la réglementation des organisations dans ce pays. Alors que, la fédération se fera aussi enregistrée au Ministère de la Planification et de la Coopération externe (MPCE) en Haïti.
C'est donc un vaste mouvement organisé qui pourrait baptiser, par exemple, de « Supporting Communities ».
Mobilisation des communautés locales dans la diaspora haïtienne
Pour arriver concrètement à la création des communautés locales, la diaspora doit être suffisamment mobilisée. En aucun cas, il ne pourra pas un acte spontané. Comme indiqué plus haut, un congrès peut être convoqué par un ou plusieurs leaders dans la diaspora haïtienne, dans chaque pays où vivent des Haïtiens. Cette activité peut être renforcée en lui donnant une couleur patriotique. Ainsi, quelques personnages connus et crédibles (des artistes, des personnages qui jouissent d’une certaine crédibilité dans le domaine de l’humanitaire, par exemple) peuvent-ils s’engager dans cette mobilisation à travers des rassemblements, des chants, des clips de sensibilisation, etc. La mission c’est de bien expliquer le mouvement à la diaspora haitienne, de montrer le concret du mouvement par son mode d’organisation, de la sensibiliser, entres autres.
Les collectivités locales peuvent aussi s’engager dans la mobilisation. En ce sens, des tournées de rassemblement, de rapprochement peuvent être réalisées par des acteurs locaux (Maire, CASEC, ASEC) dans la diaspora haïtienne dans divers pays. Cette démarche visera à sensibiliser les originaires des différentes communes sur le développement de leurs communautés d’origines, partout où ils évoluent dans la diaspora. Néanmoins, il faut que ces acteurs soient crédibles. Cette démarche paraît être plus raisonnable que celles qui tendent à rechercher des coopérations avec d’autres municipalités des autres pays qui ne débouchent généralement sur rien de concret. C’est sûr que les migrants haïtiens aimeraient bien participer dans le développement de leurs communautés natales comme ils le font à l’égard des communautés où ils vivent à l’étranger.
Il est certain que les migrants haïtiens, à travers leurs forces de travail, participent dans le développement économique des pays étrangers et financent les projets de développement de ces pays en payant des taxes. Or ils n’ont presque pas contribué dans le développement réel de leurs communautés natales, à travers des projets de développement, faute de la mise en place des mécanismes crédibles.
Intérêt de la diaspora dans des projets de développement local
Souvent des originaires de quelques communes cherchent un groupe de référence au lieu de s’approprier au groupe d’appartenance. Ils développent une sorte de complexe, donc ils n’ont pas souvent affirmé leurs origines. Affirmer leurs origines semble être déshonorant, car quelques communes du pays sont confrontées gravement à des problèmes de services sociaux de base et de développement. Pour ces raisons et bien d’autres, certaines personnes (en Haïti ou à l’étranger) ont souvent camouflé leurs origines pour adopter une autre commune apparemment plus développée. Ainsi, quelques originaires de Gros-Morne disent qu’ils sont des Gonaïves. Ceux de Boucan-Carré affirment qu’ils sont de Mirebalais. D'autres de Thomonde, Thomassique, Maïssade disent qu’ils sont de Hinche, etc.
Mais, en réalité au lieu de se référer à une autre commune, participer au développement de leur sienne serait leurs préférences. Mais ils ne trouvent pas l’opportunité réelle. Ce mouvement leur accordera l’occasion de le faire, puisqu’ils peuvent financer et décider des projets de leurs communautés d’origines. Le choix des projets à financer se fera suivant les réalités culturelles et socioéconomiques des communautés locales, et suivant les besoins identifiés par la population et les décideurs locaux ensemble avec la diaspora. En ce sens des projets de santé, d’adduction d’eau potable, agricoles, etc. peuvent être décidés.
Les projets retenus seront financés avec les fonds générés par les communautés locales de la diaspora haïtienne, en collaboration avec les autorités locales. La mairie ou le CASEC exécute les projets alors que le bureau de la communauté de la diaspora locale contrôle les dépenses et supervise le déroulement des travaux. Une synergie sera donc dégagée. Ces projets seront non seulement des sources d’emplois pour les communautés, porteurs de bien-être à la population locale, mais également des espaces de valorisation des experts locaux et ceux de la diaspora haïtienne. Car, les projets seront conçus et exécutés par des experts haïtiens qui se trouvent tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger. Ce faisant, la grande partie des capitaux investis dans des projets ne retourneront pas dans les pays étrangers, contrairement aux aides habituelles de la communauté internationale à Haïti. Ce sera en quelque sorte un gain pour l’économie locale et nationale.
Mode opératoire des communautés locales de la diaspora
Les communautés locales de la diaspora haïtienne auront un caractère transnational. Leurs activités concerneront tant des pays étrangers qu’à Haïti à travers la fédération des communautés. La fédération coordonne les activités de tous les représentants de pays, alors que les représentants de pays coordonnent les activités de tous les représentants des communautés locales dans chaque pays. Les représentants des communautés locales auront pour tâches de mobiliser les migrants pour participer et rester attacher au mouvement. Les migrants donnent leur contribution sans passer par les représentants. La fédération des communautés gère les fonds collectés par les communautés locales de la diaspora. C’est-à-dire, elle reçoit et décaisse les fonds des communautés pour des projets locaux en Haïti et le fonctionnement des bureaux. S’agissant des communautés locales, elles seront également implantées dans les communes. Des accords de partenariat avec les collectivités locales haïtiennes (Mairie, ASEC, CASEC) seront développés. Dans cette dynamique de partenariat, les mairies peuvent loger dans leurs locaux les bureaux des communautés locales de la diaspora haïtienne dans les communes. Pour faire fonctionner les bureaux des communautés locales dans les communes, un coordonnateur et un secrétaire suffisent. Les recrutements se feront suivant les prescrits des réglementations. Ces employés tireront leurs salaires des fonds générés des communautés locales de la diaspora haïtienne.
Mécanisme de génération des fonds de développement
Pour générer des fonds d’investissement, le principe de la solidarité se révèle intéressant. Les membres des communautés locales contribueront seulement à la hauteur de cinq (5) dollars par mois, de manière régulière, au fonds dénommé fonds de développement communal. Chaque communauté locale aura une caisse qui sera gérée par la fédération des communautés. Considérons la commune de Lascahobas. Disons que 500 lascahobassiens se trouvent en France, 2000 aux États-Unis, 1000 au Brésil, 300 au Canda, 2000 au Chili, 150 dans les Antilles. Cela donne un effectif de 5900 fils de Lascahobas qui sont à l’extérieur de leurs communautés natales. Suivant des calculs bruts, au bout d’une année il est possible de récolter 354000 dollars au profit de la commune.
Par ailleurs, il est admis que ces calculs sont primaires. Ils sont pleins de lacunes lorsqu’un ensemble de paramètres ne sont pas pris en considération. Le nombre des lascahobassiens émigrés peut être soit supérieur ou inférieur par rapport au nombre considéré. De plus, en aucun cas tous les lascahobassiens dans la diaspora haïtienne ne seront pas partie prenante d’une telle initiative. Encore, en dépit de la volonté du migrant, diverses situations peuvent l’empêcher de contribuer tous les mois. Mais, en dépit que ces calculs soient jugés lacuneux, l’idée c’est de démontrer comment on peut arriver à la création de fonds communaux dans la diaspora haïtienne.
Cependant, en plus des contributions régulières ou non des membres des communautés locales, on peut recourir à d’autres initiatives comme des fundraising au profit des communes. Des dons pourront être recueillis. Ce que font certaines ONG internationales. Or ces institutions internationales collectent des fonds au nom du peuple haïtien, alors que les résultats de leurs activités sont peu satisfaisants. Les projets réalisés ne servent pas vraiment à changer la situation de la population. Toutefois les problèmes aient résolu dans les communautés, leur mission touchera à leur fin, tandis qu’elles veulent encore exister. Cette source de financement, les communautés locales de la diaspora haïtienne peuvent tenter de la partager avec les ONG internationales.
Également, le sens de la solidarité des habitants ne doit pas être négligé dans la conception du mouvement, c’est-à-dire le matériel humain. En ce sens, une partie des dépenses des projets qui seront réalisés peut être assurée par la force de travail des habitants dans les différentes communautés. Il en est de même pour les experts locaux. La construction du canal d’irrigation à Ouanaminthe est un exemple parfait de solidarité et de coude à coude des habitants d’Haïti.
Mécanisme d’inspiration de confiance
Une fois que la diaspora haïtienne est mobilisée, pour diminuer les risques, inspirer la confiance, c’est-à-dire donner une base solide au mouvement, il faut institutionnaliser ce dernier en mettant en place des règlements et des méthodes de régulation. Entres autres, une charte et un acte constitutif doivent réglementer le fonctionnement des communautés locales ainsi que la fédération des communautés. Ces instruments établiront le fonctionnement des institutions, les responsabilités des acteurs, les modes de recours judiciaires, la résolution des différends, etc. Ces cadres réglementaires définiront également la durée des mandats des différents représentants, les dirigeants de la fédération et la mission de ces derniers.
En vue de primer la transparence, les mairies ou les CASEC qui exécutent des projets rendront des rapports consécutifs aux bureaux des communautés locales de la diaspora dans les communes. Ces rapports peuvent être contre vérifiés, si c’est nécessaire. Encore dans la dynamique de la transparence, chaque année la fédération des communautés locales de la diaspora haïtienne organisera une assemblée générale en Haïti. Seront siégés les différents représentants des bureaux locaux des communes, les représentants de pays, les dirigeants de la fédération. Lors de cette assemblée, des rapports seront soumis par la fédération aux représentants de pays dans la diaspora haïtienne. Les représentants de pays, à leur tour, communiqueront ces rapports aux différents représentants des communautés locales dans la diaspora haïtienne. Par contre, les rapports et les réalisations du mouvement seront disponibles sur le site internet de la fédération afin que les contributeurs puissent les consulter.
Concernant les fonds collectés, la fédération mettra à jour les informations sur ces fonds tous les trois mois. Ces informations seront distribuées dans les mails des contributeurs sous forme d’un bulletin électronique.
Tout représentant de pays, tout représentant des communautés locales, des contributeurs qui ne sont pas satisfaits d’un rapport ou auraient une suspicion légitime en ce qui concerne la mauvaise gestion de fonds auront la possibilité de protester, devant qui de droit, suivant les dispositions régissant le fonctionnement du mouvement.
Conclusion
À travers cette réflexion, il est démontré comment la diaspora haïtienne pourrait être une vectrice réelle de développement local, suivant le schéma proposé. Par contre, le schéma proposé peut renforcer le mode de développement inégal des territoires. Car les fonds des communautés ne seront jamais égaux. D’ailleurs, toutes les communes n’ont pas une quantité égale de membres dans la diaspora haïtienne. Aussi, tous les migrants n’auront jamais un même niveau de conscience patriotique et de groupe. D’autres causes peuvent s’ajouter. Mais, ce modèle proposé pourrait quand même être plus efficace que l’aide publique au développement de la communauté internationale. Car dans ce modèle, les acteurs locaux, la diaspora et la population locale sont des décideurs. En même temps, il est prévu de créer des emplois, mettre en valeurs les ressources humaines locales, donc une bonne partie des capitaux investis resteront dans le pays, sans compter des projets qui seront des initiatives viables.
En terme de perspectives, de tels mouvements n’assujettissent pas l’État dans ses fonctions régaliennes, donc la diaspora ne remplacera pas l’État. C’est pourquoi, pour qu’un tel idéal soit réalisable, il faut que l’État assume ses responsabilités, en garantissant un climat de paix, de sécurité et de justice.
Une telle initiative ne pourra pas également empêcher la diaspora haïtienne de demander des comptes à l’État haïtien des fonds prélevés sur leurs transferts en Haïti, et exiger des investissements de l’État dans les différentes communautés du pays.
[i] Voir Hein de Haas (2010). « Migration et développement : une perspective théorique ». In International Migration Revues, Vol. 44. P. 227-264. L’auteur a déniché la thématique développement et migration. Il montre, en utilisant diverses théories de la migration, la relation entre les deux notions ci-indiquées. Il a fait un équilibre entre les différents paradigmes qui explique la relation entre le développement et la migration.
[ii] Voir Benoît Joachim (2014). Les racines du sous-développement en Haïti. Éditions de l’Université d État d’Haïti. 345 pp. Dans une partie de ce texte, l’auteur explique que quelques colons ont émigrés vers les États-Unis pour s’échapper du massacre des révoltés dès le début de la révolution haïtienne.