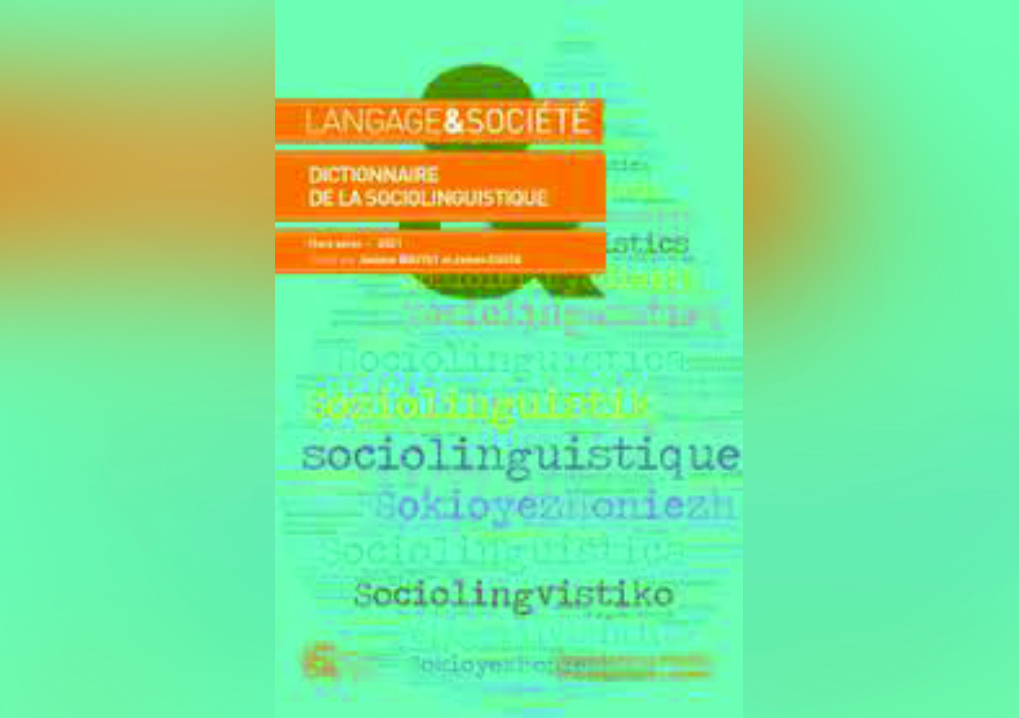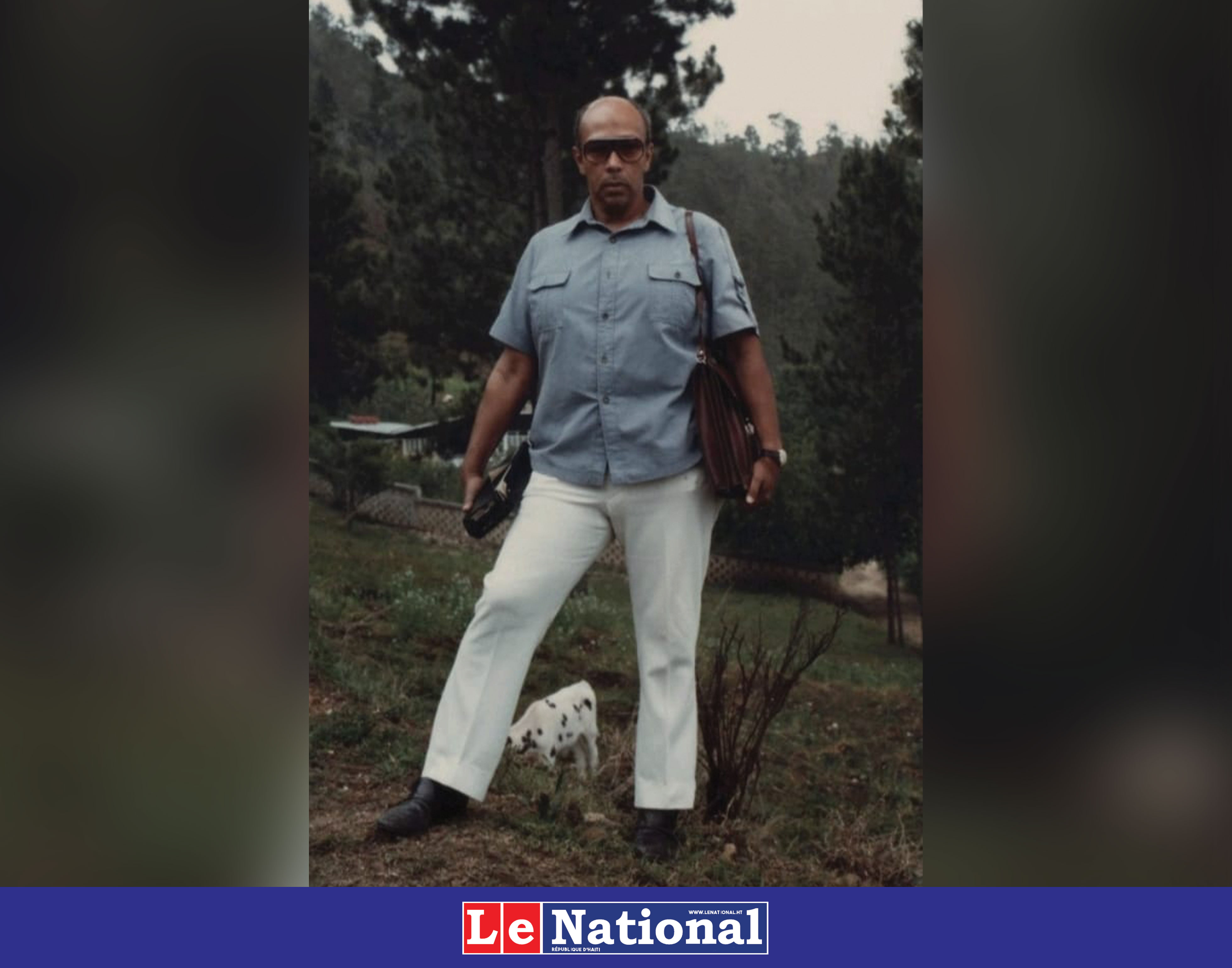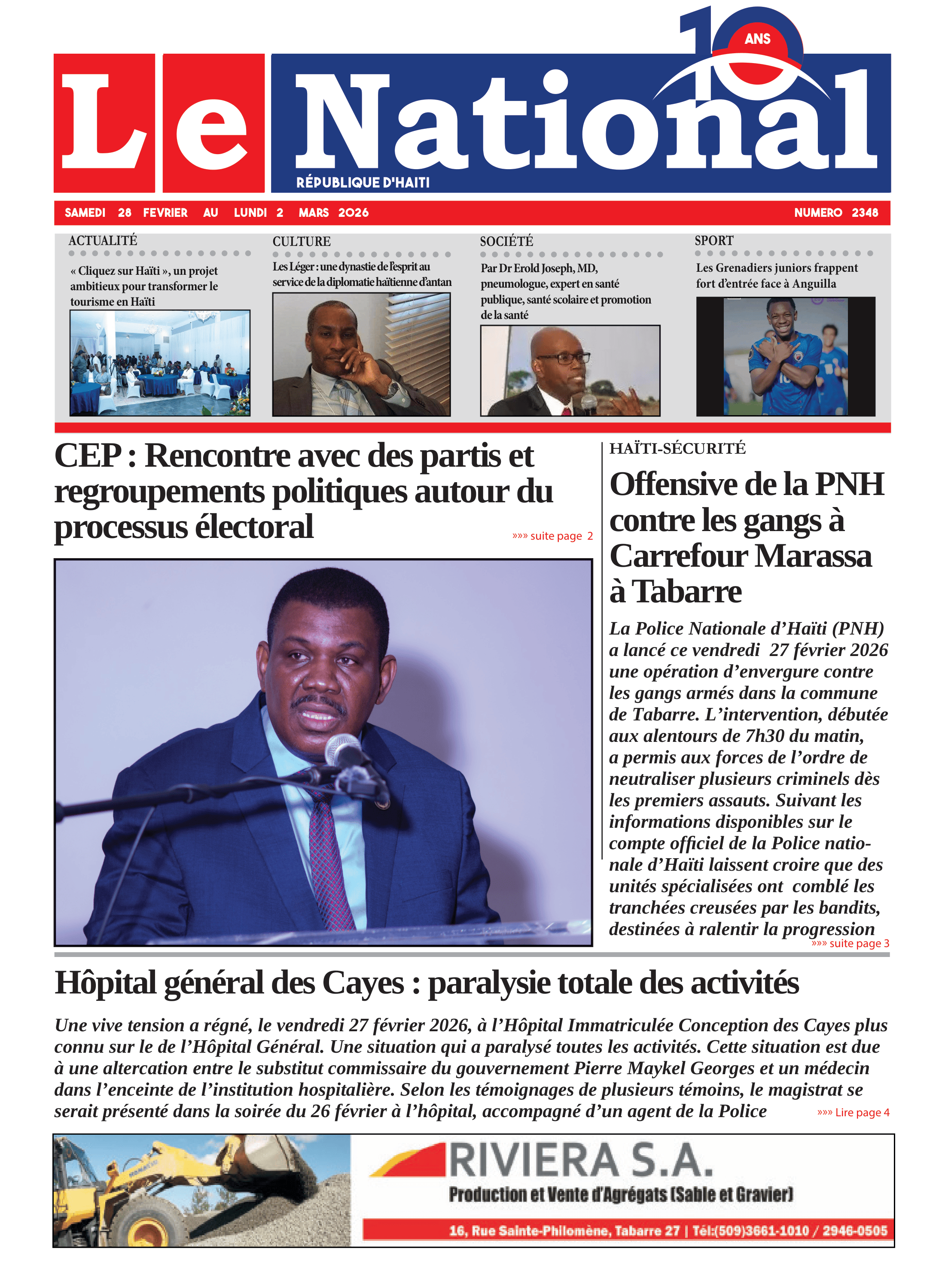Note introductive de Robert Berrouët-Oriol
Les lecteurs du National liront avec intérêt cet article du linguiste Giovanni Agresti intitulé « Droits linguistiques » et paru dans la revue « Langage et société » 2021/HS1 (Hors-série pages 115 à 118). La notion de « droits linguistiques » est apparue pour la première fois en Haïti en 2011 dans le livre de référence « L’aménagement linguistique en Haïti : enjeux, défis et propositions » (par Robert Berrouët-Oriol et al., Éditions de l’Université d’État d’Haïti et Éditions du Cidihca). Cette notion est parfois employée dans la presse et dans certains textes institutionnels mais il n’est pas acquis que sa signification et sa portée soient véritablement comprises de l’ensemble des locuteurs et encore moins qu’elle soit au cœur des interventions de l’État, en particulier dans le domaine éducatif. À bien situer la communauté de vision et d’objectifs qu’il y a entre les articles 5 et 40 de la Constitution haïtienne de 1987 et la Déclaration universelle des droits linguistiques de 1996 au regard de l’inexistence d’une politique linguistique nationale de l’État haïtien, il est nécessaire de s’approprier la notion centrale de « droits linguistiques » afin d’intervenir efficacement dans nos choix politiques de société et dans l’action collective ciblant le futur aménagement simultané de nos deux langues officielles, le créole et le français. Le lecteur désireux d’approfondir le sujet traité et les aspects conceptuels qui lui sont liés lira avec profit deux textes majeurs du juriste haïtien Alain Guillaume : (1) « L'expression créole du droit : une voie pour la réduction de la fracture juridique en Haïti » (Revue française de linguistique appliquée 2011/1 (Vol. XVI) ; (2) « Pour un encadrement juridique de la didactisation du créole en Haïti », article paru dans le livre collectif de référence « La didactisation du créole au cœur de l’aménagement linguistique en Haïti » (par Robert Berrouët-Oriol et al., Éditions Zémès et Éditions du Cidihca, mai 2021). Pour un éclairage ciblé de la notion de droits linguistiques en Haïti, voir le livre de Robert Berrouët-Oriol, « Plaidoyer pour les droits linguistiques en Haïti / Pledwaye pou dwa lengwistik ann Ayiti » (Éditions du Cidihca et Éditions Zémès, 2018).
D’où l’intérêt, pour les locuteurs haïtiens, de lire avec attention l’article du linguiste Giovanni Agresti titré « Droits linguistiques ». Giovanni Agresti est professeur des Universités en Sciences du langage à l’Université Bordeaux Montaigne en France. Il a fondé en 2008 l’Association LEM-Italia (Langues d’Europe et de la Méditerranée) et est, depuis 2016, le délégué de La Renaissance française pour l’Italie. Il est parmi les fondateurs, en 2018, du Réseau international POCLANDE (Populations, cultures, langues et développement), dont il est actuellement le Président. Il s’intéresse depuis environ vingt-cinq ans à la diversité linguistique et à sa valorisation. Il a créé en 2007, à l’Université de Teramo (Italie), la conférence internationale annuelle « Journées des droits linguistiques », devenue en 2015 le Premier Congrès mondial des droits linguistiques. Il dirige trois collections scientifiques et a publié de nombreux ouvrages et articles, principalement dans les domaines de la linguistique française, de la sociolinguistique, des droits et politiques linguistiques et de celle qu’il a baptisée la « Linguistique du développement social. (Source : Réseau international POCLANDE, n.d.)
Article de Giovanni Agresti
Les droits linguistiques (DL) sont des repères juridiques permettant de gérer la diversité linguistique notamment dans des contextes marqués par un multilinguisme inéquitable.
Dans les sociétés démocratiques et pluralistes, le droit vise à protéger des individus fragiles ou des groupes minoritaires qui autrement seraient discriminés ou marginalisés par les respectives majorités. Ainsi, à la suite du rapporteur spécial des Nations unies sur les questions relatives aux minorités (2017), peut-on affirmer que les DL « sont des droits de l’homme qui ont un impact sur l’utilisation des langues ou les préférences linguistiques des autorités gouvernementales, des individus et de toute autre entité ». Cette définition s’inspire sans doute de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) qui établit que « chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés » sans distinction « de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion […] » (art. 2). Cela dit, pour repérer la première règlementation de la question linguistique, on peut remonter jusqu’à la Constitution belge de 1831.
Si la définition onusienne des DL est consensuelle, à l’aune des lois et politiques linguistiques nationales, elle est loin de faire l’unanimité : parce que les DL ne sont pas considérés partout comme des droits humains ; parce que, lorsqu’ils le sont, il n’est pas sûr que leur mise en œuvre soit cohérente. On doit dès lors parler de DL sur le papier et de DL sur le terrain.
Cette diversité d’interprétations et d’actualisations des DL s’explique facilement : un DL doit d’abord être conforme aux fondements constitutionnels, aux traditions culturelles et aux politiques publiques de tel État ou de telle collectivité locale. Or, ces fondements et ces pratiques peuvent diverger beaucoup d’un pays à l’autre. Ainsi en est-il, par exemple, de la France par rapport à l’Italie : alors qu’en Italie les DL sont inscrits depuis 1948 parmi les principes fondamentaux de la Constitution (« La République protège par des normes particulières les minorités linguistiques », art. 6) et appliqués concrètement à travers une loi nationale (Loi n° 482 de 1999) et plusieurs lois régionales, en France la protection des langues régionales a été longtemps limitée à la sphère de l’éducation (Loi Deixonne de 1951), n’a été constitutionnalisée qu’en 2008 et ne figure qu’à l’article 75-1 de celle-ci (« Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France »).
Cette différence résulte évidemment de l’histoire de ces deux pays. L’article 6 de la Constitution italienne se veut une « réparation historique » des torts subis pendant la dictature fasciste par les minorités ethnolinguistiques établies depuis plusieurs siècles sur le sol italien : il est donc inspiré de principes en phase avec le respect des droits de l’homme. En revanche, l’article 75-1 de la Constitution française est l’aboutissement d’un long processus de reconnaissance, non pas de groupes minoritaires, mais de langues minoritaires historiquement enracinées dans une région donnée (le breton en Bretagne, le basque en Pays basque, le corse en Corse, etc.) : il est donc inspiré de principes patrimonialistes. La protection assurée par le droit ne concerne que les patrimoines linguistiques, et exclut dans ce domaine toute forme de discrimination positive à l’égard de qui que ce soit : d’après le législateur, cette discrimination, encore que positive, porterait atteinte aux principes fondamentaux de la République.
Afin de différencier ces deux démarches, le Conseil de l’Europe (COE) a adopté respectivement la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (1995) et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (1992). Souplesse oblige, la structure de cette dernière permet une adhésion « à la carte » de la part des gouvernements signataires, qui peuvent s’engager à plusieurs niveaux, faiblement ou fortement, et qui peuvent modifier, dans le temps, leur type d’engagement - concernant par exemple la promotion de telle langue minoritaire dans les médias, à l’école ou dans les services publics, etc.
Il n’y a donc pas qu’un modèle ou qu’une interprétation des DL. Ainsi, ces derniers font régulièrement l’objet d’analyses comparées (de Varennes, 1996). Une récente étude (Poggeschi, 2010) aboutit à une taxinomie des DL, de première, deuxième et troisième « espèce ». Les premiers relèvent des droits fondamentaux généraux (non-discrimination sur base linguistique) et s’accompagnent des devoirs linguistiques (connaissance de la langue du pays où l’on souhaite s’intégrer, indispensable pour mieux exercer les droits fondamentaux) ; les seconds sont en revanche les droits des minorités ; les derniers concernent enfin la reconnaissance, même partielle, des DL des étrangers. Peu de pays assurent de nos jours ce type de protection (Canada, pays scandinaves et en partie l’Allemagne). Dans cette perspective complexe, plusieurs auteurs prônent la notion de « citoyenneté linguistique », liée à la justice sociale.
Agissant à la lisière de droit, langue(s) et société, le juriste ne saurait travailler en solo à l’élaboration des DL. Pour bien agir, il faut d’abord bien nommer ; mais, pour bien nommer, il faut bien connaître le terrain, ce qui relève de la compétence du sociolinguiste. D’où l’émergence du profil hybride du jurilinguiste. L’Académie internationale de droit linguistique (Montréal) est animée par cet esprit d’interdisciplinarité.
La dialectique entre langue, droit et société affecte la catégorisation, ou typologie sociolinguistique des langues, qui accompagne voire précède la formalisation juridique (CLME 2020) : si en Italie on use dans les textes officiels du désignant minoranza linguistica, en France on parle plutôt de « langue régionale », en Espagne de lengua propia, en Belgique de « langue endogène », au Canada de « langue ancestrale », au Mexique de lengua indígena, etc. Parfois, une même catégorie peut prêter à confusion : « langue nationale » en Europe, renvoie généralement à la (aux) langue(s) officielle(s) du pays, alors qu’en Afrique francophone, il s’agit le plus souvent d’une langue locale dont la diffusion peut même être considérable (peul, bambara, éwé…) mais dont le statut n’est en aucun cas celui de langue officielle d’État. Inversement, en Europe la « langue officielle » est généralement celle qui est parlée par l’écrasante majorité de la population, tandis que dans les anciennes colonies d’Afrique une langue officielle comme le français n’est parlée que par une minorité de citoyens.
Le problème de la catégorisation interagit constamment avec celui des représentations sociales des langues. Tant que l’occitan n’a été représenté que comme un patois à éradiquer, impossible de le reconnaître comme patrimoine de la nation. De même, tant que les Rroms seront perçus comme nomades, malgré leur sédentarisation, difficile de les reconnaître comme minorité linguistique historique dans les pays, comme l’Italie, qui privilégient les langues territoriales dans leur système de DL. Ajoutons à cela qu’une langue est toujours un ensemble de variétés linguistiques, distribuées à leur tour selon une hiérarchie (Blommaert, 2001).
Ces exemples montrent à quel point les représentations sociales peuvent conditionner la reconnaissance juridique des langues minoritaires, surtout lorsqu’il est question de stigmatisation. Par conséquent, ils montrent aussi que le rôle du sociolinguiste ou de l’historien des langues dans la définition et l’application des DL, loin d’être anodin, est tout à fait nécessaire.
Références bibliographiques
• Blommaert J. (2001), « The Asmara declaration as a sociolinguistic problem : reflections on scholarship and linguistic rights », Journal of Sociolinguistics 5 (1), p. 131-142.
• CLME (2020), Base de données textuelle « Catégorisation des langues minoritaires en Europe ». En ligne : https://www.msha.fr/baseclme/.
• Conseil de l’Europe (1992), Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. En ligne : https://www.coe.int/fr/web/conventions/fulllist/-/conventions/treaty/148.
• Conseil de l’Europe (1995), Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. En ligne : https://www.coe.int/fr/web/minorities/.
• Déclaration universelle des droits linguistiques (1996). En ligne : https://www.pencatala.cat/wp-content/uploads/2016/02/dlr_frances.pdf.
• De Varennes F. (1996), Language, Minorities and Human Rights, La Haye/ Boston, Kluwer Law International.
• Poggeschi G. (2010), I diritti linguistici. Un’analisi comparata, Rome, Carocci.
• Rapporteur spécial des Nations unies sur les questions relatives aux minorités (2017), Droits linguistiques des minorités linguistiques. Guide pratique pour leur mise en œuvre, Genève, Nations unies. En ligne :https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Minorities/SR/LanguageRightsLinguisticMinorities_FR.pdf.
Étude présentée par :
Robert Berrouët-Oriol
Linguiste-terminologue
Montréal, le 6 février 2022