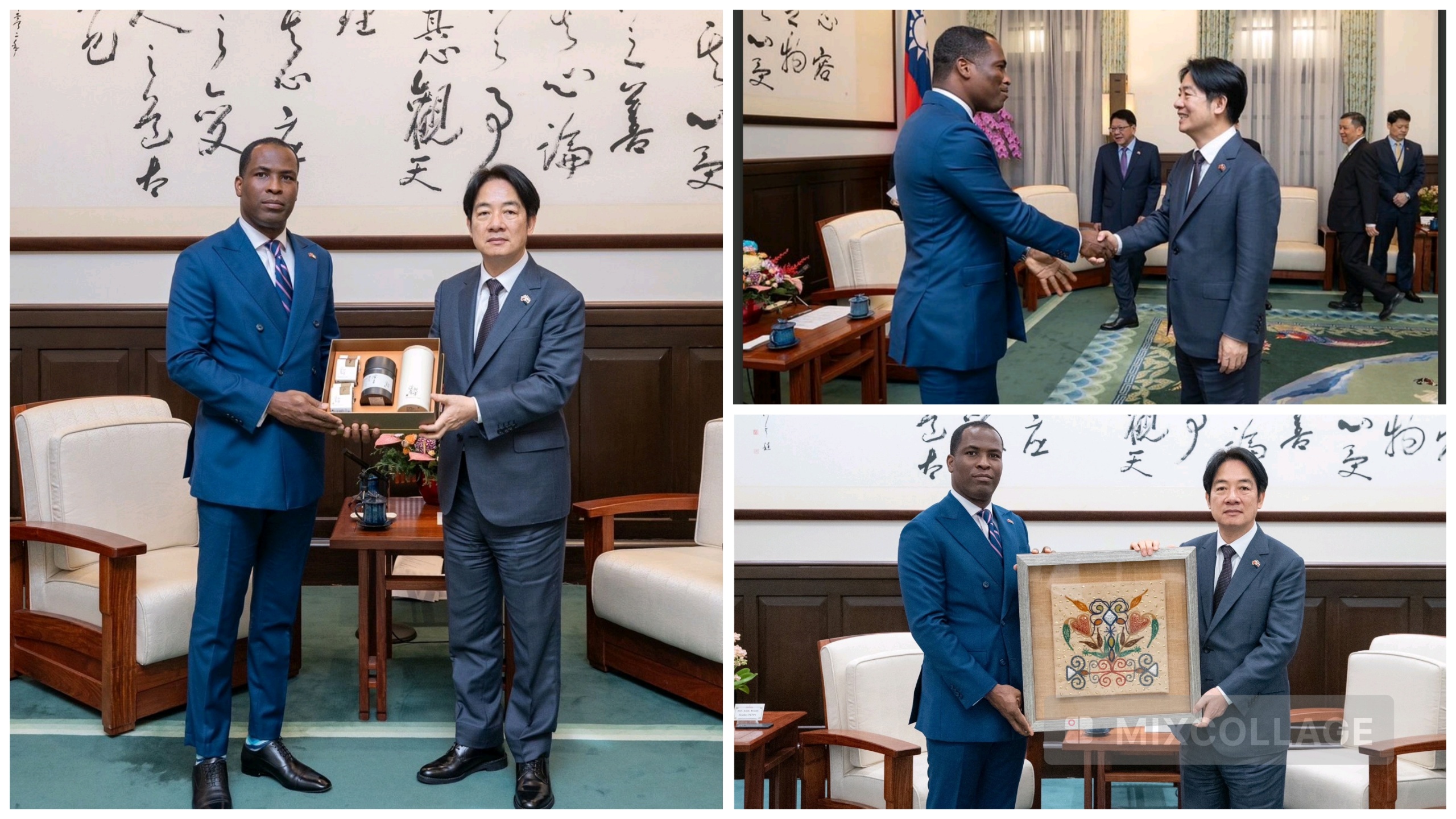Le terme bibliographie est en lui-même polysémique. D’après le dictionnaire Larousse Grand format de 2015, la bibliographie se définit comme : « la liste des ouvrages cités ou utilisés dans un livre ; répertoire des écrits, livres articles traitant d’une question, concernant un auteur »[1]. C’est dans cette acception que le terme est employé dans les travaux académiques universitaires comme les mémoires et les thèses, la bibliographie se trouvant alors à la fin du document. Dans le domaine de la Bibliothéconomie et des Sciences de l’Information, le terme a un sens encore plus large, lato sensu, et se rapporte au répertoire arrangé par ordre alphabétique des auteurs de toute la production écrite d’une nation depuis ses origines. Elle comporte alors les ouvrages, les revues et les articles de journaux et les documents administratifs de toute cette collectivité. Ce travail de base étant fait, il se produit chaque année une mise à jour de la bibliographie de base ainsi constituée à partir des nouvelles publications. Ainsi, en plus de la bibliographie de base, il y aurait des répertoires bibliographiques pour chaque année présentant sous la même forme ordonnée la production intellectuelle écrite du pays selon les normes de la description bibliographique. Dans certains pays, c’est la bibliothèque nationale qui prépare et publie chaque année ce document. Dans d’autres pays, il y a des sociétés savantes bibliographiques mêmes mandatées par l’État pour cette tache demandant de hauts niveaux de spécialisation. La bibliographie nationale d’un pays est un précieux outil de recherche pour l’historien, le documentaliste, le chercheur. C’est un guide inestimable et précieux permettant de retrouver rapidement les ressources documentaires disponibles dans un pays sur un sujet ou sur une période bien déterminée de son histoire. La bibliographie est un indicateur objectif du niveau de développement de la production intellectuelle écrite d’un pays. Elle est un instrument de recherche et d’analyse dans les cours de bibliothéconomie comparée. Elle peut donner lieu à des travaux ultérieurs plus précis, plus élaborés comme des guides thématiques bibliographiques, des présentations des extraits des revues ou des journaux, des commentaires de l’orientation thématique de base de la production intellectuelle annuelle d’un pays parmi les aires déterminées comme poésie, littérature, beaux-arts, Sciences sociales, recherches, essais, histoire, économie, sciences et technologie... Les guides bibliographiques thématiques sont très appréciés des chercheurs qui se les procurent régulièrement. Ils sont exposés dans des bibliothèques suivant la nature de la bibliothèque. Par exemple, si c’est une bibliothèque en Sciences agronomiques, il serait intéressant d’avoir un guide bibliographique sur les publications effectuées au cours de l’année précédente sur la question agricole dans le pays.
En Haïti, la production intellectuelle est très dispersée. La production des auteurs étrangers sur le pays l’est encore davantage. Pour toutes ces raisons, il faut un travail d’inventaire donnant, même approximativement, un état de la question. Deux auteurs, deux pionniers ont fait un travail énorme et de qualité en la matière. Il s’agit de M. Ulrick Duvivier avec son ouvrage Bibliographie générale et méthodique d’Haïti[2] en 1941 et de M. Max Bissainthe avec son Dictionnaire de bibliographie haïtienne[3] en 1951. Quant au premier ouvrage, Mme Ertha Pascal-Trouillot, ancienne Présidente de la République d’Haïti en 1990, nous dit que « cet ouvrage, préfacé par Pauléus Sannon et introduit par le Président Sténio Vincent, était considérable, tant par la variété que par la richesse de sa documentation; pendant de longues années, l’auteur a visité une quantité inestimable de bibliothèques, tant à l’étranger que dans le pays. Ce livre a été publié, avec l’autorisation des héritiers Duvivier, par le gouvernement de Sténio Vincent à l’occasion du Congrès des Caraïbes tenu en 1941 »[4].
Et, jusqu’au moment présent où nous écrivons, ces deux ouvrages représentent des lectures et consultations obligées sur la production intellectuelle haïtienne depuis la période coloniale. C’était un grand départ et Haïti, dans le domaine de l’établissement de sa bibliographie, occupait alors une place de choix au niveau de toute la Caraïbe. Analysant la parution de l’ouvrage de M. Max Bissainthe, l’historien Gabriel Debien, le grand spécialiste des questions coloniales selon notre Professeur Pierre-Marie Victor, devrait écrire en 1952, dans la Revue française des Amériques : « C’est le prolongement de Duvivier sur un plan qui a permis, tout en travaillant plus vite, de présenter les publications sous un jour nouveau. Il ne s’agit point d’élaborer un choix, de juger, mais d’énumérer tous les imprimés publiés en Haïti et sur Haïti, de dresser le catalogue d’une Bibliothèque complète. L’ordre le plus simple était l’ordre alphabétique des auteurs, et celui des titres quand l’auteur était inconnu. Pas de disposition plus pratique »[5]. Le travail de M. Max Bissainthe, nous dit encore M. Gabriel Debien, « nous révèle d’un coup tout ce qu’on peut trouver à Port-au-Prince, à la jeune Bibliothèque Nationale, à la Bibliothèque Haïtienne des Frères [de l’Instruction Chrétienne], à la Bibliothèque du Séminaire-Collège [Saint Martial], [...] et dans certaines collections particulières. Almanachs, abécédaires, annuaires, mandements, catéchismes, circulaires administratives, codes, conférences, discours officiels, notices nécrologiques, recueils poétiques, romans, essais, dictionnaires, ouvrages historiques, livres en créole, livres en français, tout est là, à son rang et c’est une révélation, car en nous mettant devant un siècle et demi de travail haïtien, ce panorama général nous fait faire un clair tour d’horizon, et dans ces conditions un compte rendu est une conclusion »[6]. Et M. Debien de conclure sur ces termes : « Ce premier ouvrage s’est attaqué à la partie la plus nécessaire, à la plus urgente. Nous avons un inventaire sûr, pratique, aussi complet qu’un homme seul pouvait le faire. Il s’arrête à 1950. Ce sont des compléments annuels qui nous sont maintenant nécessaires; puis une autre encyclopédie : un dictionnaire des articles de revues et journaux, certes plus difficilement réalisable et plus compliqué, par nature, que celui des imprimés. Mais M. Bissainthe a la méthode, la patience et le courage. Viendrait ensuite, mais nécessairement collective, l’entreprise d’un autre classement, critique, explicatif, historique, qui présenterait autour de grands problèmes les livres essentiels et à côté les articles; qui nous dirait les buts, les sources, la valeur de ces travaux et les polémiques qui les ont suivis »[7].
C’était tout dit ou presque. Sauf que M. Debien n’avait pas pu prédire le grand tumulte qui allait embraser le pays cinq années plus tard, soit la fin des années 1950 et le début des années 1960, sur le plan politique et qui ramenait à la dernière priorité des pouvoirs publics des initiatives pour réaliser la bibliographie complète du pays. Par contre, il faut noter que ce fut pendant cette décennie 60-70 que les pays de l’Amérique latine et de la Caraïbe, avec l’appui de l’ Organisation des Etats Américains (OEA) d’une part et de l’Alliance pour le Progrès d’autre part, avaient reçu des appuis considérables en matière de formation de cadres en bibliothéconomie, en matériel de base et en financement pour l’équipement de leurs bibliothèques publiques. Ce qui va leur permettre d’avancer dans le domaine tant sur le plan quantitatif que qualitatif. A Porto-Rico, par exemple, l’Ecole de Bibliothéconomie fut fondée durant cette décennie et la Bibliothèque centrale de l’Université, Bibliothèque M. José M. Lazarro, fut construite au cours des années 1950, par l’architecte Henry Klumb. Or en Haïti, durant la même période, il y a eu un recul significatif en la matière dont on n’a pas encore mesuré toute la portée. Des familles entières laissèrent le pays emportant avec elles et leurs collections entières et leurs compétences. Des bibliothèques furent fermées comme ce fut le cas pour celle du Petit-Séminaire Collège Saint-Martial, ou encore forcées de réduire leurs activités par la dictature. L’acte de lecture même était poursuivi avec rage par des agents et des espions de la Préfecture de Port-au-Prince. Des livres et des catégories de livres furent interdits purement et simplement. C’est à partir de cette décennie que la production intellectuelle d’Haïti s’était déplacée de plus en plus vers l’extérieur à cause des intellectuels laissant le pays et publiant désormais leurs ouvrages à l’étranger. L’étude systématique des catalogues des bibliothèques publiques haïtiennes le prouve clairement. Une véritable hémorragie. M. Maurice A. Sixto racontait comment, quand il n’était pas encore aveugle, de son balcon à Kinshasa, au Congo, il voyait passer des cohortes entières d’anciens élèves qu’il avait connus à Port-au-Prince, à l’Institution Saint-Louis de Gonzague. Dans un tel contexte aussi agité que troublé, la préparation des bibliographies du pays ne saurait être une priorité de l’État. Pendant longtemps les travaux de M. Duvivier et de M. Bissainthe n’eurent pas de suite[8]. Il y eut plus tard les travaux de M. Hénock Trouillot[9], de M. Jean Wilfrid Bertrand et de Mme Daniela Devesin[10], de M. Max Manigat[11], de M. Patrick Tardieu[12], du Professeur Michel Hector[13] ou encore de M. Léon-François Hoffmann[14]. Le Professeur Watson Denis[15] avait préparé toute une bibliographie internationale sur Toussaint Louverture. Des universités étrangères comme celles de Floride ou de Duke présentent de grandes collections et des guides bibliographiques de grande valeur sur Haïti. Il faut accorder une place de choix aux travaux de Michel Laguerre[16], de David P. Geggus ou encore de Jacques de Cauna[17]. Mais de nos jours encore, les vœux de l’historien Gabriel Debien en matière de la bibliographie complète et exhaustive du pays et des outils de recherche en histoire à partir de cette même bibliographie pouvant guider nos étudiants et chercheurs, ces vœux disons-nous, formulés depuis l’année 1952 pour la publication d’une bibliographie globale, régulière et annuelle du pays, gardent encore toute leur actualité et attendent… leur concrétisation.
Jérôme Paul Eddy Lacoste
Responsable académique de la Faculté des Sciences Humaines de l’Université d’État d’Haïti
Mai 2024
NOTES
[1] Dictionnaire Larousse Grand Format. p. 157.
2 Ulrick Duvivier (1941). Bibliographie générale et méthodique d’Haïti (en deux tomes). Imprimerie de l’État. Port-au-Prince, Haïti.
3 Max Bissainthe (1951). Dictionnaire de bibliographie haïtienne. Scarecrow Press, Washington.
4 Ertha Pascal-Trouillot / Ernst Trouillot (2001). Encyclopédie Biographique d’Haïti. Editions Semis, Montréal. Source : http://sites.rootsweb.com/~htiwgw/familles/fiches/054117.htm. Accédé le 20 juin 2020.
5 Gabriel Debien (1952). Compte rendu de [BISSAINTHE, Max, Dictionnaire de bibliographie haïtienne. Washington, 1951. In-8, 1051 p.] Revue d’histoire de l’Amérique française, 6(3), 453–455. https://doi.org/10.7202/301542ar
6 Ibid.
7 Ibid.
8 D’ailleurs ces ouvrages sont réellement introuvables sur le marché du livre en dépit des actualisations de M. Max Bissainthe. Ils sont consultés seulement par des spécialistes. J’en appelle à une nouvelle édition bien établie de ces deux ouvrages de grande portée historique pour le livre haïtien. J’ai toujours pensé que les travaux de ces pionniers comme M. Duvivier et M. Bissainthe devraient être connus du grand public haïtien et des étudiants des programmes de licence dans les sciences humaines et sociales.
9 Hénock Trouillot. « Bibliographie féminine. Epoque coloniale et XIXème siècle ». In Jacques de Cauna « Bibliographie historique haïtienne 1980-1986 (période coloniale et révolutionnaire) ». Revue d’histoire d’Outre-Mers. Année 1987 276 pp. 333-350
10 Jean Wilfrid Bertrand et Daniela Devesin. « Bibliothèques haïtiennes d’aujourd’hui », in la Revue Conjonction, Port-au-Prince, 127-128, décembre 1975, 9-53.
11Max Manigat (1979). Haitiana 1971-1975, Collectif paroles, La Salle, P.Q., 84 p. M. Max Manigat avait préparé une bibliographie spéciale sur les ouvrages en langue anglaise publiés sur Haïti. Voir sous ce rapport le numéro spécial de la Revue de la Société haïtienne d’Histoire et de Géographie d’avril-Septembre 2003consacré au Bicentenaire de la mort de Toussaint Louverture. Dans ce même numéro de la Revue, le lecteur trouvera une précieuse généalogie de la famille de Toussaint Louverture par M. Robert Price et une excellente étude bibliographique du Frère Ernest Even intitulée « Toussaint Louverture dans deux bibliothèques haïtiennes ». A consulter.
12 Patrick Tardieu (1983). « Bibliographie haïtienne 1981-1982 ». Revue Conjonction. Numéro 160. Port-au-Prince.
13 Miche Hector (1993). L’historiographie haïtienne après 1946 sur la révolution de Saint-Domingue Annales historiques de la Révolution française Année 1993 293-294 pp. 545-553 Fait partie d’un numéro thématique : Révolutions aux colonies.
14 Léon-François Hoffmann (1992).Bibliographie des études littéraires haïtiennes 1804-1984. EDICEF / AUPELF
15 Watson Denis. « Une bibliographie internationale sur Toussaint Louverture ». Revue Itinéraires. Centre de Recherches Historiques et en Sociologiques (CREHSO) de la Faculté des Sciences Humaines (FASCH) de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH). Edition spéciale, Décembre 2004.
16 Michel Laguerre (1982). The Complete Haitiana. A Bibliographical Guide to the Scholarly Literature 1900-1980, Kraus International Publications, Milwood, New Jersey, London, et Nendeln, Liechtenstein, 2 vols, 1982, 1.564 p.
17 Jacques de Cauna. « Bibliographie historique haïtienne 1980-1986 (période coloniale et révolutionnaire) ». In : Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 74, n°276, 3e trimestre 1987. Économie et société des Caraïbes XVII-XIXe s. (2e Partie) pp. 333-350.
Légende : Une photo historique : M. Francisco de la Division hispanique de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis d’Amérique (USA), l’Ambassadeur haïtien Joseph D. Charles et M. Max Bissainthe (troisième à partir de la gauche), alors Directeur de la Bibliothèque Nationale d’Haïti (BNH) parlant avec le Dr. Evans. Cette photo a été prise au cours de la célébration des cent cinquantième anniversaires de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis d’Amérique en avril 1950. Source : Library Information Bulletin, April 1999.
[1] Dictionnaire Larousse Grand Format. p. 157.
[2] Ulrick Duvivier (1941). Bibliographie générale et méthodique d'Haïti (en deux tomes). Imprimerie de l'Etat. Port-au-Prince, Haïti.
[3] Max Bissainthe (1951). Dictionnaire de bibliographie haïtienne. Scarecrow Press, Washington.
[4] Ertha Pascal-Trouillot / Ernst Trouillot (2001). Encyclopédie Biographique d’Haïti. Editions Semis, Montréal. Source: http://sites.rootsweb.com/~htiwgw/familles/fiches/054117.htm. Accédé le 20 juin 2020.
[5] Gabriel Debien (1952). Compte rendu de [BISSAINTHE, Max, Dictionnaire de bibliographie haïtienne. Washington, 1951. In-8, 1051 p.] Revue d'histoire de l'Amérique française, 6(3), 453–455. https://doi.org/10.7202/301542ar
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] D’ailleurs ces ouvrages sont réellement introuvables sur le marché du livre en dépit des actualisations de M. Max Bissainthe. Ils sont consultés seulement par des spécialistes. J’en appelle à une nouvelle édition bien établie de ces deux ouvrages de grande portée historique pour le livre haïtien. J’ai toujours pensé que les travaux de ces pionniers comme M. Duvivier et M. Bissainthe devraient être connus du grand public haïtien et des étudiants des programmes de licence dans les sciences humaines et sociales.
[9] Hénock Trouillot. « Bibliographie féminine. Epoque coloniale et XIXème siècle ». In Jacques de Cauna « Bibliographie historique haïtienne 1980-1986 (période coloniale et révolutionnaire) ». Revue d'histoire d’Outre-Mers. Année 1987 276 pp. 333-350
[10] Jean Wilfrid Bertrand et Daniela Devesin. « Bibliothèques haïtiennes d'aujourd'hui », in la Revue Conjonction, Port-au-Prince, 127-128, décembre 1975, 9-53.
[11] Max Manigat (1979). Haitiana 1971-1975, Collectif paroles, La Salle, P.Q., 84 p. M. Max Manigat avait préparé une bibliographie spéciale sur les ouvrages en langue anglaise publiés sur Haïti. Voir sous ce rapport le numéro spécial de la Revue de la Société haïtienne d’Histoire et de Géographie d’avril-Septembre 2003consacré au Bicentenaire de la mort de Toussaint Louverture. Dans ce même numéro de la Revue, le lecteur trouvera une précieuse généalogie de la famille de Toussaint Louverture par M. Robert Price et une excellente étude bibliographique du Frère Ernest Even intitulée « Toussaint Louverture dans deux bibliothèques haïtiennes ». A consulter.
[12] Patrick Tardieu (1983). « Bibliographie haïtienne 1981-1982 ». Revue Conjonction. Numéro 160. Port-au-Prince.
[13] Miche Hector (1993). L'historiographie haïtienne après 1946 sur la révolution de Saint-Domingue Annales historiques de la Révolution française Année 1993 293-294 pp. 545-553 Fait partie d'un numéro thématique : Révolutions aux colonies.
[14] Léon-François Hoffmann (1992).Bibliographie des études littéraires haïtiennes 1804-1984. EDICEF / AUPELF
[15] Watson Denis. « Une bibliographie internationale sur Toussaint Louverture ». Revue Itinéraires. Centre de Recherches Historiques et en Sociologiques (CREHSO) de la Faculté des Sciences Humaines (FASCH) de l'Université d'Etat d'Haïti (UEH). Edition spéciale, Décembre 2004.
[16] Michel Laguerre (1982). The Complete Haitiana. A Bibliographical Guide to the Scholarly Literature 1900-1980, Kraus International Publications, Milwood, New Jersey, London, et Nendeln, Liechtenstein, 2 vols, 1982, 1.564 p.
[17] Jacques de Cauna. « Bibliographie historique haïtienne 1980-1986 (période coloniale et révolutionnaire) ». In: Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 74, n°276, 3e trimestre 1987. Economie et société des Caraïbes XVII-XIXe s. (2e Partie) pp. 333-350.