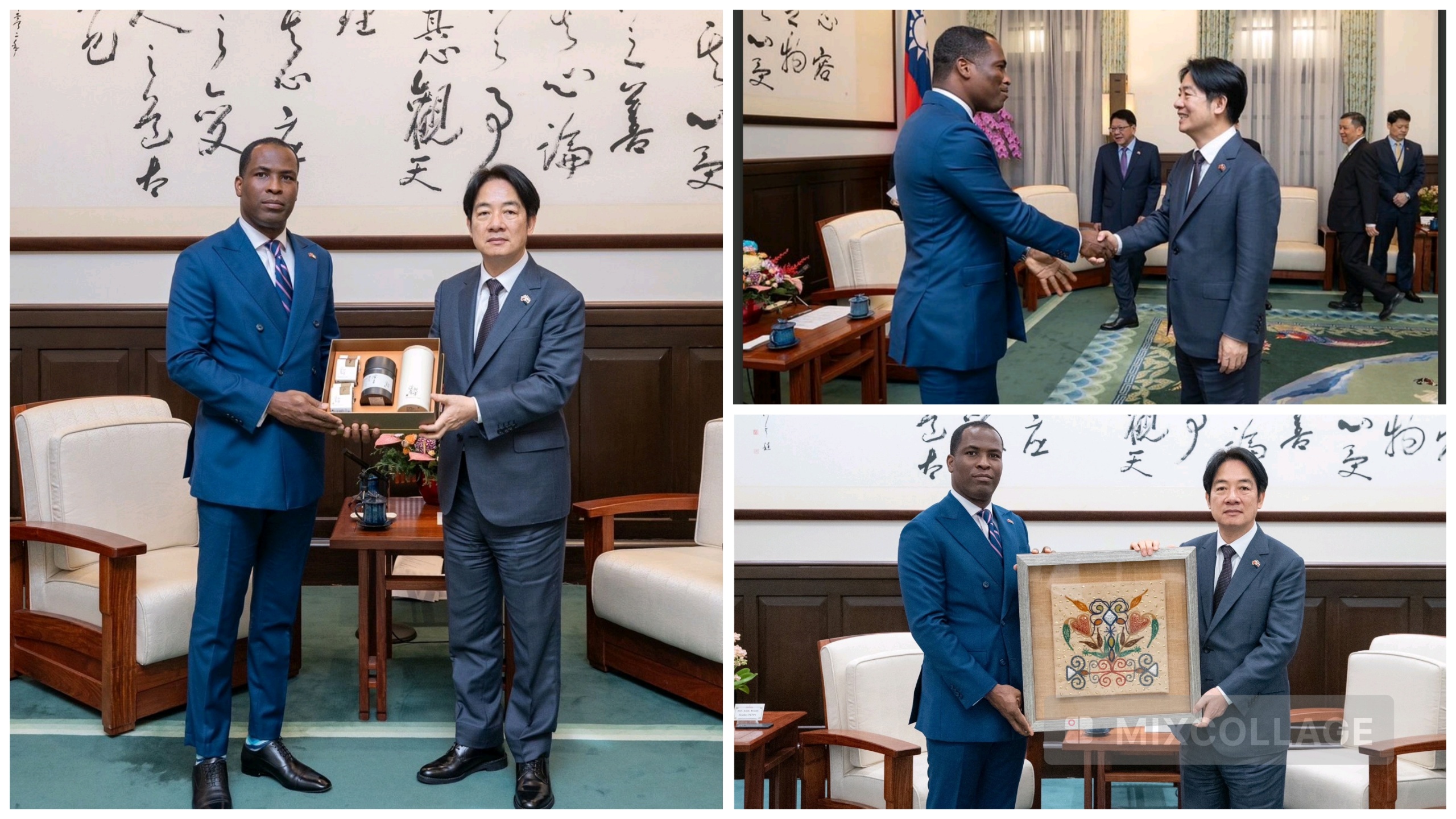1. Contexte et justificatif
Après plus de 220 ans d’indépendance d’Haïti, la nation haïtienne n’a jamais pu se développer convenablement comme les autres nations et patauge encore dans un niveau de pauvreté inacceptable. À côté de la mal gouvernance qui a trop souvent prévalu au XIXe siècle et du peu d’efforts entrepris par les gouvernements successifs pour relancer sur de nouvelles bases l’économie haïtienne, les effets de ce qu’il y a lieu d’appeler la double dette de l’indépendance ont incontestablement contribué à l’appauvrissement de la nation. Le remboursement de cette double dette a privé le pays, et cela pendant longtemps, d’une bonne partie de ses revenus d’exportation tout en l’obligeant à établir au profit de l’ancienne puissance coloniale des préférences commerciales extraordinaires. Par ailleurs, le règlement de différentes affaires avec des puissances internationales (Affaire Luders, Affaire Rubalcava, Affaire du capitaine Batsch, Affaires Mews, …) a imposé unilatéralement à l’État haïtien le versement d’importantes sommes tirées du Trésor Public.
En Haïti, cette dette et son remboursement ont à plusieurs reprises heurté la conscience nationale. À l’occasion du soulèvement d’Acaau (1844-1846), les paysans révoltés se sont indignés du poids de cette « dette monstrueuse ». En général, l’État haïtien a eu du mal à faire accepter à la population ce lourd fardeau. Se sont multipliées les rebellions de militaires et les manifestations de rues, nous a dit Gusti-Klara Gaillard. Cette mobilisation a été souvent réprimée en Haïti même avec une extrême rigueur, Cette historienne est sans doute la spécialiste mondiale de la problématique de la double dette de l’Indépendance. Dans une interview accordée en 1990 à Radio Haïti Inter, elle a même attiré l’attention sur l’exceptionnelle et exclusive contribution de la paysannerie haïtienne au remboursement de cette fameuse dette grâce à la production caféière, principale denrée d’exportation. Dans ce contexte, elle avait même parlé d’une culture caféière « pillée ». Elle nous a appris aussi qu’en 1915, Davilmar Théodore s’était opposé au paiement de cette dette.
Au début des années 2000, l’ancien Président d’Haïti, Jean-Bertrand Aristide, avait porté à la conscience nationale et internationale l’injustice et les effets négatifs de la dette de l’indépendance. Peut-être pour la première fois, le montant de cette dette avait été calculé et divulgué. Plus près de nous, cette lourde saignée des caisses de la jeune nation vient d’être rappelée, en février 2023, par le « New York Times » qui a consacré à cette étude du temps et des moyens d’une certaine importance. Par ailleurs, le Haut-Commissaire aux Droits Humains de l’ONU, Monsieur Volker Turk, a tout récemment reconnu publiquement, dans un forum des organisations de la société tenu à Genève le 19 avril dernier, la nécessité pour la France de rembourser à Haïti la double dette de l’Indépendance. Le même jour, plus d’une vingtaine d’organisations non gouvernementales françaises ont aussi appelé formellement le gouvernement français à restituer à Haïti le montant de la double dette remboursée durant 150 ans par Haïti. Dans un colloque international organisé, le samedi 4 mai de cette année, par des leaders catholiques de l’Amérique Latine, le lien a été établi une nouvelle fois par deux anciens présidents du Costa Rica et du Chili, entre la situation chaotique que connait Haïti et le poids du remboursement à l’ancienne métropole française de la fameuse dette de l’indépendance.
Par ailleurs, il faudra profiter de l’occasion pour aborder deux autres aspects des rançons imposées à la jeune nation dans le cadre de la « diplomatie de la canonnière » :
- Les préférences commerciales extraordinaires au profit de la France imposées à Haïti dans le cadre de l’Edit de Charles X sur la reconnaissance de l’indépendance. Elles ont duré près de deux siècles et ont pris fin en 1987. Elles aussi ont causé des torts immenses a la nation ;
- Les rançons versées à l’occasion de ces « Affaires » qui parsèment l’histoire d’Haïti du XIXe et du début du XXe siècle, notamment l’Affaire de l’Amiral Rubalcava (Espagne), l’Affaire du Capitaine Batsch (Allemagne), l’Affaire Luders (Allemagne), les Affaires Mevs, les emprunts forces (Etats-Unis), l’Affaire de la SHADA (Etats-Unis).
La nation haïtienne devrait chercher à obtenir leur restitution à leur valeur actuelle de l’Espagne, de l’Allemagne, de la Grande Bretagne et des Etats-Unis.
Une mobilisation de l’opinion publique nationale d’abord, mais aussi internationale s’impose. L’Université d’État d’Haïti, dans sa fonction d’intelligence nationale et dans son rôle de vigie pour la société haïtienne, peut contribuer à l’avancement de ces dossiers afin que le pays obtienne restitution.
Par ailleurs au moment où le pays se trouve entrainé dans une spirale de violences et de destructions inouïes, l’aboutissement de tous ces dossiers de restitution aidera certainement à aborder la problématique de la reconstruction de manière plus sereine et plus efficace.
Voilà pourquoi, le Conseil Exécutif de l’Université d’État d’Haïti met en place un « Groupe de travail » sur les études à engager et sur la mobilisation à créer autour de la problématique de la restitution.
2. Objectifs
Les objectifs de ce groupe de réflexion et de travail sont :
• De mener toutes études et enquêtes pour compléter et renforcer le dossier ;
• D’entreprendre les démarches nécessaires pour finaliser les calculs des montants à réclamer ;
• D’informer et de sensibiliser l’État Haïtien et les secteurs organisés de la société haïtienne sur les différents éléments du dossier ;
• De diffuser et publier au bénéfice de l’opinion publique nationale et internationale les différents éléments du dossier ; il sera notamment important de créer une véritable mobilisation nationale, à travers les différents regroupements nationaux des divers niveaux des Collectivités Territoriales ;
• D’identifier tous les acteurs nationaux et internationaux capables de faire avancer ce dossier
• De prendre les dispositions nécessaires, dans le cadre d’une grande coalition d’acteurs nationaux et internationaux, pour faire aboutir ce dossier.
3. Stratégies
Toutes les stratégies de recherche, d’enquête, d’étude et de marketing peuvent être utilisées par le groupe de réflexion et de travail en vue d’aboutir à ses objectifs.
Ainsi, le groupe de réflexion et de travail pourra, dans un souci de résultats et d’efficacité, recourir aux compétences des différentes entités de l’UEH pour avancer dans ses enquêtes et études.
Il fera appel au Conseil de l’Université pour relayer et mobiliser les ressources nécessaires auprès des composantes de l’UEH.
Le groupe de réflexion et de travail cherchera auprès du Conseil Exécutif de l’UEH les moyens et ressources nécessaires pour l’accomplissement de son mandat.
4. Activités
Le groupe de réflexion et de travail entreprendra toutes les activités d’enquête et d’études (documentation, revue de littérature, entretiens, sondages, e-questionnaires, focus groupe, etc.) pour compléter les données du dossier.
Des activités d’information, de publication et de diffusion seront nécessaires pour faire progresser le dossier, ainsi que des émissions de radiodiffusion et de télévision ; des capsules audio-visuelles, des articles, des conférences, des journées d’études ou des colloques peuvent être envisagés par le groupe de réflexion et de travail.
5. Composition
Ce groupe sera formé de personnels académiques de l’UEH et d’autres universités, mais aussi de certaines personnalités nationales et internationales.
Voici une première liste de travail qui est à compléter :
• Professeure Judith Blanc, psychologue
• Professeur Eddy Labossière, économiste
• Professeur Alvarez LOUIS, historien
• Glodel Mezilas, spécialiste en relations internationales
• Professeur Alix RENÉ, historien
• Professeur Jean Marie THEODAT, géographe
6. Résultats attendus
Au terme du mandat du groupe de réflexion et de travail sur la restitution, l’Université d’État d’Haïti recevra un dossier complet des dettes et autres obligations que la France et d’autres pays auront à restituer à la nation haïtienne.
Par ailleurs, un regroupement de personnalités nationales et internationales sera aussi soumis à l’attention du Conseil Exécutif. Ce regroupement définira les voies et moyens susceptibles de créer une véritable mobilisation nationale et internationale et sera habilité à engager les premiers échanges avec les États concernés. Il demeure entendu qu’une deuxième phase de négociations sera établie directement entre les États qui prendront à témoin différents regroupements autorisés de personnalités.
Rectorat de l’Université d’Etat d’Haïti