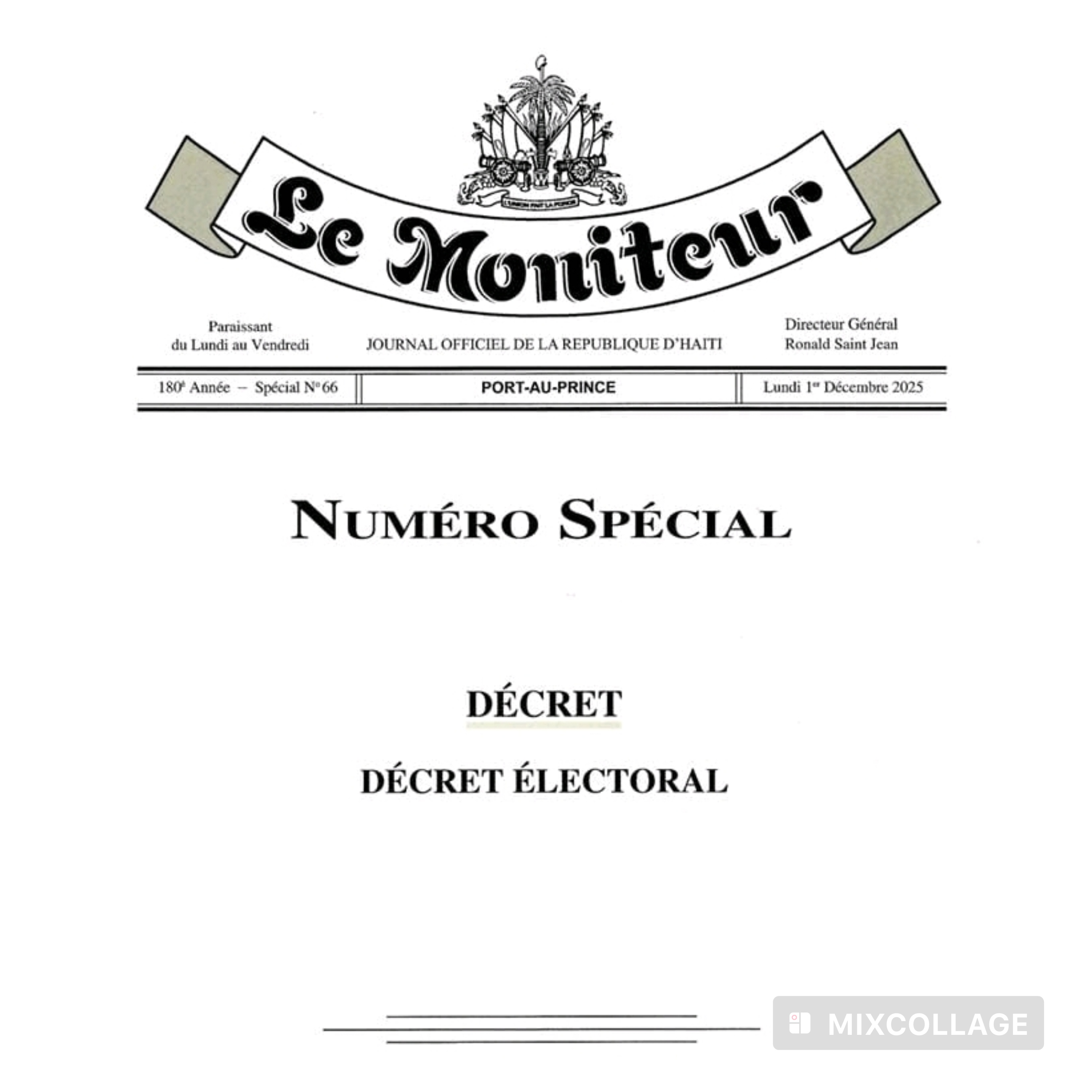Le calvaire des sans-papiers
En France, il est une épreuve bien connue, presque devenue un rite de passage pour des millions d’étrangers : le renouvellement de la carte de séjour. C’est un parcours semé d’embûches, une course d’endurance administrative où la patience se transforme en supplice.
Trois types de titres de séjour jalonnent ce labyrinthe administratif typiquement français: la carte d’un an, celle de trois ans, et la précieuse carte de résident valable dix ans, le Graal bureaucratique, rare et convoité par les temps qui courent où chaque étranger est considéré potentiellement dangereux.
Mais à chaque nouveau ministre de l’Intérieur, la partition change. Chacun y va de sa recette, de son tour de vis, comme un chef d’orchestre qui ne joue qu’à l’oreille de sa propre idéologie. Et voilà qu’avec le ministre Bruno Retailleau, la mélodie est devenue plus dure, plus tranchante. Son discours sur l’immigration sonnait comme un tambour de guerre : il fallait montrer la fermeté, rassurer l’opinion, et surtout, marquer les esprits par une politique dite « de l’ordre ».
Républicain de stricte obédience, Retailleau a laissé derrière lui des cailloux tranchants, semés sur le chemin des préfectures pour baliser des étrangers vers l’exclusion. Ces cailloux, il les a déposés sous la forme d’une circulaire, rédigée comme une épée suspendue au-dessus de la tête de milliers de résidents étrangers.
Ce texte administratif vient d’introduire dans les couloirs administratifs une suspicion nouvelle, une logique de tri quasi morale. Sec et sans âme, ce papier a la froideur d’un décret romain : désormais, il ne suffit plus de vivre, de travailler, de contribuer à la société : il faut “faire ses preuves”, comme si vingt ou trente ans de présence ne valaient rien. À certains égards, c’est presque un concours de loyauté : prouver son intégration, sa valeur, sa conformité.
Les étrangers doivent désormais passer des épreuves invisibles — maîtriser les codes, les mots, les gestes — pour mériter ce que la République leur avait déjà accordé : le droit d’être simplement là.
Les portes qui se claquent
L’homme n’a pas caché pas son jeu. L’immigration est devenue pour lui le cheval de bataille, la bannière sous laquelle il avance pour s’imposer sur la scène politique. Son passage au ministère marque un tournant : durcissement des critères, délais à rallonge, exigences absurdes. Dans certaines préfectures, les portes se sont refermées comme des mâchoires d’acier. Les droits pourtant inscrits dans la loi se sont dissous dans la pratique. Un exemple : un Tunisien, quarante ans de travail en France, parfaitement intégré, payant ses impôts, respectant les règles. Du jour au lendemain, un mur administratif infranchissable s’élève devant lui. Son dossier se perd dans les tréfonds des couloirs préfectoraux, comme une bouteille jetée à la mer. Des mois passent, puis les années. Sans papiers, il perd son emploi, son logement, et jusqu’à sa dignité. C’est une lente descente, un effacement social, une invisibilisation orchestrée.
Combien sont-ils, celles et ceux qui, après vingt, trente, parfois quarante ans de vie en France, se retrouvent soudain sans papiers, comme effacés d’un trait de plume administrative ? Ces hommes et ces femmes avaient des titres de séjour, des contrats, des familles, des souvenirs gravés dans les murs de ce pays. Ils avaient planté leurs racines ici, souvent plus profondément que bien des « Français de souche » autoproclamés. Et pourtant, les voilà aujourd’hui suspendus au-dessus du vide, victimes d’une politique préfectorale devenue machine à exclure. Les préfectures, censées être les portes de la République, ressemblent de plus en plus à des forteresses de verre : transparentes en apparence, mais impénétrables pour ceux qu’on n’y veut plus. Derrière chaque guichet, une décision peut faire basculer une vie entière. Et quand l’État se fait sourd, le silence devient un verdict.
Ces étrangers de longue date ne demandent pas des privilèges, seulement le droit de continuer à exister légalement dans le pays qu’ils ont aidé à bâtir. Mais la nouvelle doctrine préfectorale, sous couvert de rigueur administrative, opère comme un tri silencieux. On ne les expulse pas toujours, non : on les laisse s’effacer, lentement, comme si l’oubli était une politique publique.
C’est un paradoxe cruel : plus on a donné à la France, plus on risque d’y devenir invisible. Les préfectures se transforment en arènes où se joue le destin d’hommes et de femmes à qui l’on demande sans cesse de redire « je t’aime » à un pays qui, parfois, ne répond plus.
L’Algérien devient le Juif d’hier !
Ce qui se rejoue, parfois, dans les discours médiatiques et politiques, c’est ce vieux réflexe français : celui de désigner un « autre » à haïr pour mieux se croire unis. Dans les préfectures, l’inégalité se lit dans les silences, dans les regards soupçonneux, dans les dossiers qu’on laisse traîner.
Et sur les plateaux de télévision, les clichés s’empilent comme des briques dans un mur invisible. Les talk-shows du soir deviennent des tribunaux improvisés où l’on juge une population entière à coups de phrases choc. Les chaînes détenues par quelques milliardaires au patriotisme d’opportunité distillent la peur à petites doses, comme un poison sucré : ça passe mieux et surtout ça vend mieux. La xénophobie, sous couvert de liberté d’expression, est devenue une monnaie d’échange médiatique. Elle s’achète, se partage, se « like ».
Quant aux Algériens résidant en France, leur situation relève presque d’une tragédie silencieuse. Ils sont souvent les héritiers d’une histoire douloureuse, coincés entre deux rives : celle du passé colonial et celle du présent administratif. Et trop souvent, cette double appartenance devient un fardeau. Dans l’imaginaire collectif, l’Algérien reste, pour une partie de la société française, une figure de l’ombre, le visage d’un malaise qu’on ne veut ni regarder ni comprendre. Les Algériens d’aujourd’hui sont traités par certains comme les Juifs d’hier — boucs émissaires commodes dans une France en quête de responsables à ses fractures. La comparaison n’est pas une équation historique, mais une alerte morale.
L’Algérien, lui, devient un personnage de fiction, caricaturé, réduit à son nom, à sa foi, à son origine. Et dans cette mise en scène de la peur, la dignité se perd comme une feuille morte dans le vent du cynisme. La République, pourtant bâtie sur les valeurs d’égalité, se trahit chaque fois qu’un guichet ferme injustement, qu’un accent devient un handicap, qu’un prénom devient un soupçon. La France aime dire qu’elle est universelle, mais elle trébuche dès qu’il s’agit d’accepter la diversité de ses propres enfants.
Maguet Delva
Paris, France