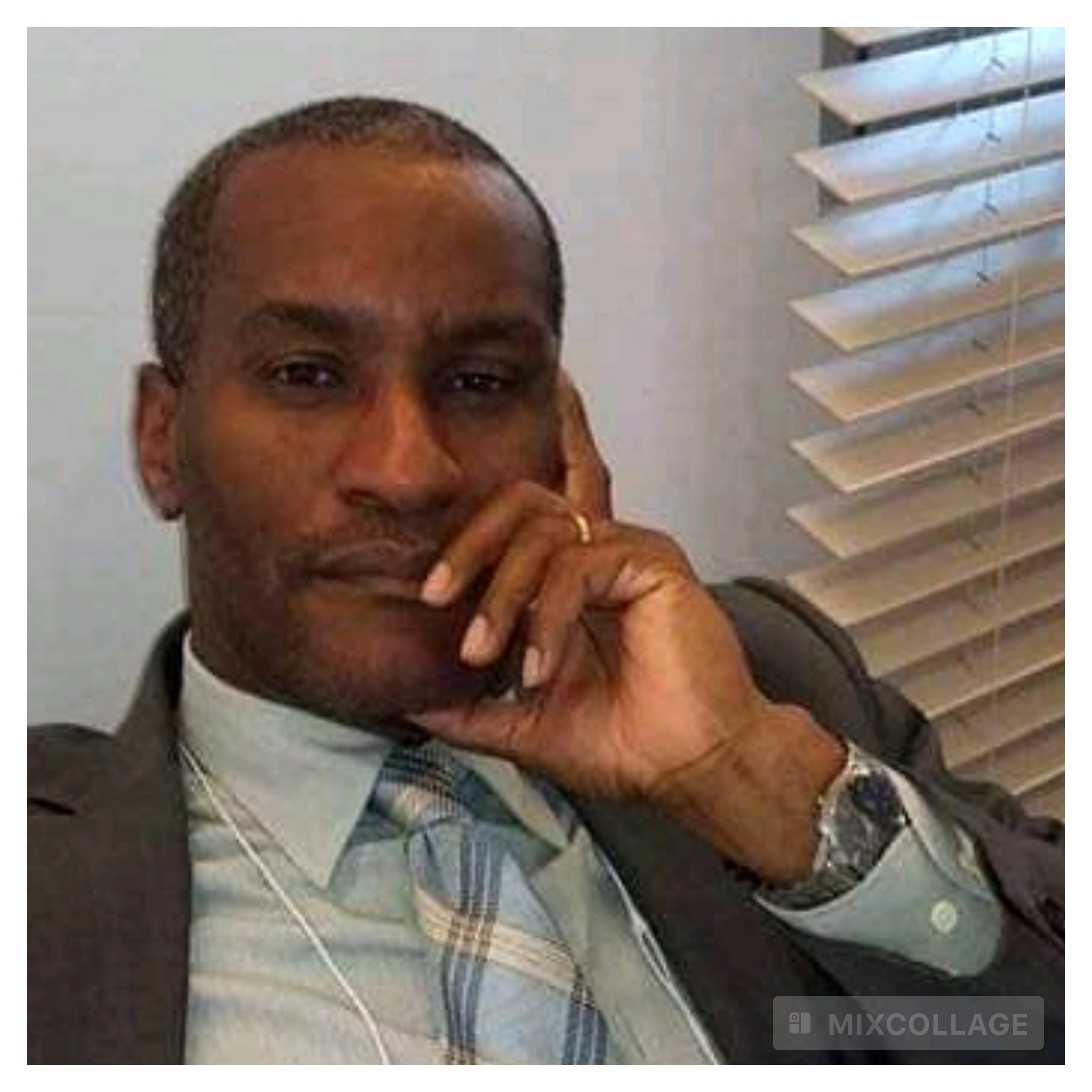Avec deux romans, un essai, un recueil de poésie et une pièce de théâtre, la rentrée littéraire française de 2025 prend des couleurs haïtiennes et un petit goût de Caraïbes. Nos compatriotes y occupent en effet le devant de la scène : Robert Philomé avec « Port-au-Prince Cotonou un écho sans retour », et Yanick Lahens avec « Passagères de nuit » signe son grand retour dans la compétition des prix. À leurs côtés, paraît aussi l’essai de l’ancien président provisoire Jocelerme Privert, « Au service d’Haïti 2001-2016, une plongée dans les coulisses politiques du pays.
La poésie n’est pas en reste : Louis-Philippe Dalembert publie son dernier recueil de poésie « L’Obscur soleil des corps » dont il donnera une lecture publique, le jeudi 11 septembre 2025 à 19h à la Maison de la Poésie (157 rue Saint-Martin, 75003 Paris).
Enfin, la scène théâtrale parisienne vibrera de nouveau au rythme de l’histoire haïtienne grâce au poète et dramaturge Éric Sauray, qui présentera une pièce historique, « Éloge funèbre de l’impératrice Marie-Claire Heureuse ». Deux représentations exceptionnelles sont prévues les samedi 18 et dimanche 19 octobre 2025 à l’Eglise de Croslay.
La rentrée littéraire en France s’annonce plus mordante que la précédente. Avec plus de 484 nouveaux romans dans les vitrines des librairies, le cru 2025 promet d’être grandiose à tous points de vue, avec des révélations d’écrivains et d’écrivaines dont je préfère taire les noms par peur d’aiguiser la jalousie. Car l’histoire des prix littéraires en France nous renseigne assez sur les intrigues des uns et des autres pour obtenir les fameux trophées. Tout, dans le domaine littéraire de ce pays, constitue un véritable parcours du combattant. Les talentueux obtiennent parfois des prix, certes, mais souvent ce sont les maisons d’édition qui décident. Avec un savoir-faire parfois limité mais beaucoup de stratégie, certains écrivains médiocres sont propulsés, tandis que de grands auteurs passent pour pertes et profits dans les mailles du filet. Ainsi l’un des plus grands écrivains haïtiens, Jean-Claude Charles, n’a reçu aucun prix, alors qu’il fut l’un des plus doués et des plus prolifiques de sa génération. Journaliste multicarte, essayiste, romancier, poète, scénariste, il n’a même pas obtenu un prix de l’Académie française pour ses poésies, notamment son recueil Négociations, véritable chef-d’œuvre. Du jamais vu en France, mais l’explication est simple : Jean-Claude Charles ne fréquentait aucune chapelle littéraire. L’homme était trop insoumis, dilettante à souhait, désintéressé, abruti par l’alcool.
Jusqu’au bout, il a pratiqué un détachement à toute épreuve, un refus des compromissions qui, sans doute, l’a définitivement écarté des circuits officiels de distribution de la grande famille des prix littéraires français. La France officielle, avide de mettre en avant ses lauréats et parfois trop prompte à décerner ses distinctions aux premiers venus même sans véritable talent a complètement oublié Jean-Claude Charles, ce « premier de la classe », comme aimait à le rappeler Dany Laferrière. Un oubli injuste, qui en dit long sur les mécanismes de reconnaissance et sur la difficulté, pour un écrivain insoumis, à trouver sa place dans un système où les prix se jouent souvent autant dans les salons et les réseaux que dans la qualité de l’œuvre elle-même.
Une bataille âpre
Au fil des ans, le côté commercial a supplanté la qualité littéraire. Les maisons d’édition savent qu’il n’y a pas d’économie du livre sans écrivains pour alimenter la machine, et elles mettent tout en œuvre pour attirer tel ou tel auteur susceptible de faire grimper le chiffre d’affaires. Dans ce contexte, les prix littéraires sont devenus de véritables baromètres, capables de mesurer le talent des uns mais surtout de générer des ventes colossales. En moyenne, un Goncourt se vend à 380 000 exemplaires, un Renaudot à 220 000, un Femina à 155 000, un Goncourt des lycéens à 125 000, un Grand Prix des lectrices d’Elle à 120 000, un Interallié à 95 000, un Médicis à 42 000. La France détient le record mondial du nombre de prix littéraires : plus de 2000, dont 200 de portée nationale. Elle est aussi deuxième au monde pour le nombre de manuscrits envoyés chaque année aux éditeurs.
Chaque année, à la même période, le monde de l’édition en France est en effervescence : plus de 29 salons du livre animent le territoire, et la moisson littéraire 2025 dépasse toutes les autres avec une trentaine de manifestations de toutes orientations. Le marché du livre et, singulièrement, celui de la francophonie, se porte bien, d’autant plus que la France n’hésite pas à subventionner la culture : le livre, le cinéma, les musées. Romans, poésies, essais, tout s’inscrit dans une vaste compétition où les éditeurs rivalisent d’astuces pour séduire l’opinion publique. Fini le temps des communications « à la papa », inaugurées par Gallimard, qui consistait à tenir les critiques littéraires dans sa poche.
Les grandes maisons Gallimard, Le Seuil, Grasset, Stock, Minuit, Flammarion, Albin Michel, Actes Sud, Robert Laffont, XO se taillent toujours la part du lion, avec plus de 400 titres. Mais des petites maisons, comme Le « Serpent à plumes » ou d’autres structures indépendantes, tentent de s’imposer. La bataille paraît perdue d’avance, tant le système du « Galligraseuil » reste verrouillé, avec ses critiques alliés et ses réseaux médiatiques bien huilés, capables de faire ou défaire un livre au-delà de sa qualité intrinsèque. Lire la critique littéraire, ces dernières semaines, relève presque du jeu de piste : on devine d’où viennent certaines attaques, à quelles obédiences journalistiques elles appartiennent, et dans quel réseau elles s’inscrivent. C’est un système parfaitement huilé, avec ses avantages et ses travers. Reste à savoir si cela sert la littérature, ou si cela ne la réduit pas à un simple produit de marchandise
Pendant longtemps, la critique a été dominée par un petit cercle de figures centrales. Les pages littéraires du journal Le Monde, dirigées d’une main de fer par Josyane Savigneau pendant plus de vingt ans, faisaient et défaisaient les réputations. Encensé par Le Monde, un auteur vendait ; égratigné, il disparaissait.
Tout le monde écrit, tout le monde veut être publié. Mais les places sont limitées, et beaucoup de plumes assoiffées se sont rabattues sur Facebook et les plateformes numériques, où pullulent des éditeurs en ligne souvent peu regardants sur les principes déontologiques du métier.
Mais Internet et Facebook ont bouleversé ce monopole. La première victime fut Savigneau elle-même, contrainte à la démission après une campagne d’écrivains dénonçant sa partialité. Le plus virulent fut Pierre Jourde, qui, se disant ignoré et vilipendé, lança un bras de fer via Internet, plongeant l’édition française dans une polémique qui dura plus d’un an. Aujourd’hui, le pluralisme numérique a emporté le monde littéraire et ses anciennes certitudes.
Liens d’Haïti avec la France
Depuis toujours, les liens entre Haïti et l’ancienne puissance coloniale se manifestent avant tout à travers cette langue française qu’ils ont en partage. De Hérard Dumesle à Juste Chanlatte, en passant par Émeric Bergeaud, considéré comme l’un des premiers romanciers haïtiens, ou encore Ida Faubert, fille du président Lysius de Salomon Jeune et figure féminine incontournable de la poésie francophone. Une longue lignée d’auteurs a écrit en français tout en portant la mémoire, les blessures et les aspirations d’Haïti. Il faut rappeler que si de grands romanciers haïtiens tels que Jean Metellus, Dany Laferrière, René Depestre et bien d’autres ont reçu des distinctions littéraires en France parfois prestigieuses, très peu sont parvenus jusqu’au prix Goncourt, sommet de la reconnaissance hexagonale. Ils ne sont que quatre à avoir franchi cette barrière symbolique.
En 2011, Lyonel Trouillot fut sélectionné avec « La belle amour humaine », un roman puissant qui interrogeait la mémoire et les fractures de l’île. En 2021, ce fut le tour de Louis-Philippe Dalembert, finaliste du Goncourt avec « Milwaukee Blues », roman salué pour sa force cosmopolite et sensible, lauréat du Choix Goncourt en Belgique, le prix Goncourt de la poésie Robert Sabatier 2024 pour l'ensemble de son œuvre
En 2022, Makenzy Orcel confirma sa stature internationale en devenant finaliste du Goncourt avec « Une somme humaine » roman monumental qui valut à l’auteur plusieurs choix Goncourt de pays francophones, pris souvent à contrepied du jury français. Enfin, en 2025, c’est au tour de Yanick Lahens, déjà lauréate du Femina en 2014 pour « Bain de lune » d’entrer dans cette illustre compétition avec « Passagères de nuit ».
Cette présence, bien que rare, témoigne de la reconnaissance croissante des écrivains haïtiens dans le paysage littéraire français. Mais elle rappelle aussi combien le chemin est semé d’embûches, tant les logiques éditoriales et les cercles d’influence parisiens demeurent sélectifs. Malgré cela, les voix haïtiennes continuent de s’imposer dans les grands débats de la francophonie, apportant à la littérature française un souffle neuf, nourri de l’histoire, de la mémoire et de l’universel.
Cette lente et difficile ascension des écrivains haïtiens vers le Goncourt en dit long sur les résistances du système littéraire français, longtemps verrouillé par les grands éditeurs parisiens et par des logiques d’appartenance. Mais elle témoigne aussi de la vitalité et de la reconnaissance croissante d’une littérature haïtienne qui, depuis des décennies, nourrit la francophonie de ses voix singulières, puissantes et universelles.
Maguet Delva