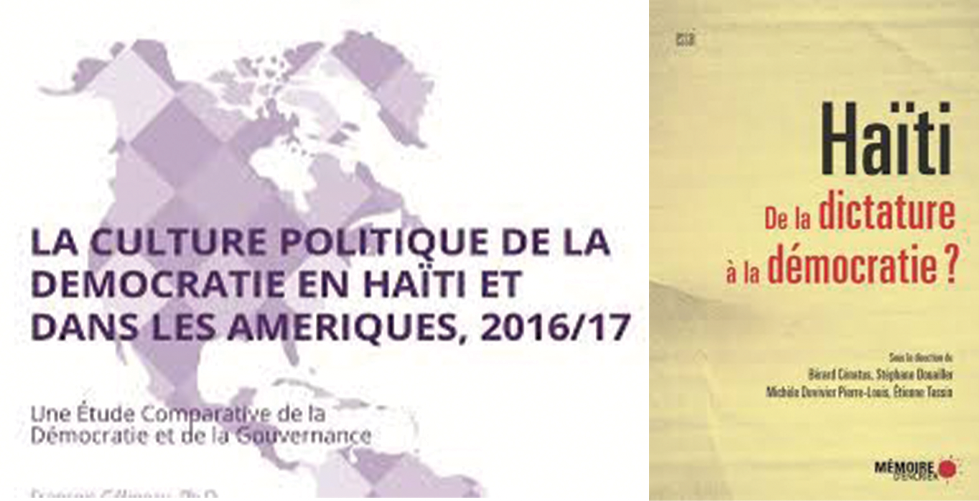Dommage que l’ancien président à vie de la République, Jean Claude Duvalier n’a pas suivi les traces de son père, en proposant une sélection d’ouvrages et des témoignages qui auraient pu contribuer dans la communication entre les générations et la modélisation de la perception de l’histoire.
Dr Rony Gilot, parmi d’autres acteurs témoins, incluant les survivants de ce régime et de cette génération, ont contribué à leur manière dans la transmission des savoirs et la valorisation des réflexions sur le sujet relatif au processus de la démocratisation, en Haïti, qui n’a certainement pas amorcé en 1986. En se référant à l’organisation du référendum de 1985, même si cette avant -dernière initiative populaire représentait pour certains une mise en scène, d’autres, plus rigides diront une mascarade, on retiendra quand même que cette flexibilité ou concession allait ouvrir les vannes des mouvements de protestation et de provocation, jusqu’à la capitalisation du régime.
Dans la présente publication, il s’agit pour nous d’extraire dans ce travail les trois dimensions culturelles qui nous intéressent, afin d’explorer la dynamique démocratique en Haïti, dans une approche inscrite dans les trois temps : Culture, Vodou et Marronnage. Quels sont les principaux événements liés à ces trois concepts qui ont influencé l’actualité politique en Haïti, en 1985, en 1986 et jusqu’en 2025, quarante plus tard ?
Dans la dynamique culturelle, qui va certainement au-delà des considérations et des contributions inscrites dans le document de recherche académique, on retiendra en particulier les sept principaux faits suivants : 1-La démocratisation des activités politiques dans le pays au lendemain de 1986 ; 2-La culture de la corruption institutionnalisée dans le processus électoral en Haïti, à travers les chantages populaires pour faire campagne et le paiement des citoyens pour aller voter ; 3-L’implication active et visible des créateurs, des talents musiciens, comédiens et animateurs culturels dans les campagnes électorales ; 4-L’utilisation des fragments ou dimensions de la culture populaire dans les communications politiques avant, pendant et après le pouvoir ; 5-Le rôle de la musique traditionnelle et engagée dans les mouvements populaires avant 1986 et au lendemain du 7 février dans le processus de démocratisation ; 6-Les industries culturelles deviennent un acteur central dans la dynamique politique et électorale pour faire danser ou dompter le peuple ; 7-L’absence de politique culturelle pour une gouvernance responsable du secteur et dans une perspective de démocratisation des services et produits culturels sur tout le territoire haïtien.
Dans le champ Vodou et démocratisation. Le bilan n’est pas forcément rose. 1-Les campagnes de rejetées et les persécutions subies par les membres de la communauté Vodou ; 2-La reconnaissance du Vodou comme religion par le président Jean-Bertrand Aristide en 2003 ; 3-La destruction de plusieurs hauts lieux Vodou et du patrimoine sacré lors des mouvements populaires ; 4-Les tentatives non durables de fédérer les acteurs du Vodou avec la fonction d’Ati National suivies par les divisions au lendemain de Max Beauvoir ; 5-La récupération politique des principaux groupes musicaux racines et leurs effritements ou reconversions au fil des temps ; 6-L’absence d’investissement significatif pour le relèvement du secteur Vodou tant dans la structuration, la formation, et le développement des infrastructures pour contribuer au développement de la cité ; 7-La démocratisation démesurée des connaissances sacrées et les savoirs mystiques du Vodou sur les médias sociaux sans aucune limite face aux lois en vigueur.
Dans le marronnage en politique, il y a lieu de considérer les principales activités politiques et les influences de cette pratique, de cette approche ou vision dans la dynamique individuelle et institutionnelle. On peut retenir sept des autres points encore plus pertinents qui définissent le marronnage dans le processus de démocratisation en Haïti. 1-L’utilisation du français par des autorités politiques qui prétendent communiquer avec la population ; 2-Les limites d’utilisation du créole dans les principaux documents officiels, administratifs et les services de base offerts à la population ; 3-L’utilisation des animations populaires entre le carnaval, le rara et d’autres animations ou diversions culturelles, pour ne pas aborder les questions sensibles et les priorités de la République ; 4-Les discours politiques et les cérémonies ou voyages et visites officiels fortement teintés par un protocole qui se démarque de toute logique démocratique ou patriotique ; 5-L’absence d’un ensemble de contenus pertinents dans le curriculum du ministère de l’Éducation nationale participe également dans une forme de marronnage pour ne pas éveiller certaines intelligences politiques ou consciences patriotiques dans les masses ; 6-Les choix des sujets proposés dans l’organisation du carnaval national souvent creux ne participent pas à une meilleure prise de conscience et de responsabilité des masses, tout en s’amusant ; 7-L’institutionnalisation du marronnage à travers le refus de valoriser le Vodou au sein des institutions, tout en les utilisant religieusement avant, pendant et après les élections par un grand nombre de dirigeants.
Dans la contribution universitaire d’Ambroise Guillaume, il y a cinq ans, en 2020, autour de l’ Analyse sociohistorique du processus de démocratisation en Haïti amorcé en 1986 : enjeu culturel et enjeu économique, disponible dans la catégorie mémoire, de l’Université du Québec à Montréal, pour boucler sa formation de maîtrise en sociologie, nous sommes invités à explorer trois des principales dimensions culturelles qui influence de façon constante la société haïtienne, et la politique en particulier. On peut citer : la culture, le Vodou et le marronnage.
D’autres mots clés, comme sociologie historique, peuple, démocratie populaire, néolibéral, représentation symbolique et communauté internationale vont s’associer avec ces trois concepts de base, pour nous aider à comprendre les différentes dimensions du processus de démocratisation en Haïti, au lendemain de 1986.
Dans le résumé de cette recherche, on peut lire qu’elle est guidée par la question générale suivante : quels sont les facteurs structurels qui expliquent le blocage de la démocratie politique en Haïti, malgré les efforts de la communauté internationale ? L’auteur précisera que son objectif est : « D’examiner sociologiquement, sur la base de la littérature existante, les principales raisons du blocage démocratique en Haïti et, plus particulièrement, leur articulation avec l’intervention de la communauté internationale. », tout en développant : « Un argumentaire qui vise à échapper à certains réductionnistes courants dans ce domaine. À cette fin, sans pour autant produire une thèse culturaliste, nous mettrons de l’avant les dimensions culturelles qui sous-tendent le processus à l’étude ».
Démocratisation populaire, le dirigeant de l’Observatoire international pour la Démocratie et la Gouvernance (OIDG), Ambroise Guillaume a choisi de centrer cet exercice académique et scientifique autour : « Du concept “démocratie populaire” dans le sens que le peuple haïtien ayant manifesté son souhait pour l’instauration de la démocratie doit être compris dans sa construction avec ses représentations symboliques comme le vaudou et la langue créole, et ce, dans le contexte du projet néolibéral mondial et de la mondialisation de la culture.
Déclinaison de la recherche en quatre chapitres, rapporte le document : Le premier traite de la problématique du travail, de la question générale et des questions spécifiques. Le deuxième est consacré au cadre théorique et à l’approche méthodologique choisie. Le troisième présente le portrait historique d’Haïti en comparaison avec la République dominicaine à travers trois périodes : esclavage, occupation états-unienne et dictature des Duvalier. Enfin, le dernier chapitre sera consacré à l’analyse du processus de démocratisation en Haïti autour de deux principaux enjeux : l’enjeu culturel et l’enjeu économique.
Dans la publication qui porte le titre : «La culture politique de la démocratie en Haïti et dans les Amériques, 2016/2017», plusieurs auteurs nous proposent un large éventail des recherches et des réflexions sur le sujet, dans cette étude comparative de la démocratie et de la gouvernance. François Gélinau, Vlaire G. Evans, Carole Wilson, Maria Fernanda Boidi, et Elizabeth J. Zechmeister explorent les différentes thématiques suivantes : le soutien à la démocratie électorale dans les Amériques ; l’offre des libertés fondamentales dans les Amériques ; la qualité de vie en Haïti ; criminalité, corruption et État de droit en Haïti ; la politique locale dans les zones cibles de l’USAID ; les orientations démocratiques dans les Amériques.
Dans chacune de ces thématiques abordées, il est possible de les associer, de les comparer, ou de les mesurer, en se servant des grilles du Vodou, de la culture et du marronnage pour comprendre les limites de la gouvernance ou du processus de la démocratisation en Haïti. La désacralisation des symboles identitaires et culturels les plus importants, comme les dates historiques, les lieux de mémoires et d’autres repères culturels importants dans la fabrication de cette nation confirment plus que jamais, les limites de la transition de 1985 à 1986, dans la démocratisation d’Haïti, malgré les changements des couleurs du drapeau, la destruction de plusieurs symboles et des institutions culturelles qui portaient les marques des Duvalier.
À suivre…
Dominique Domerçant