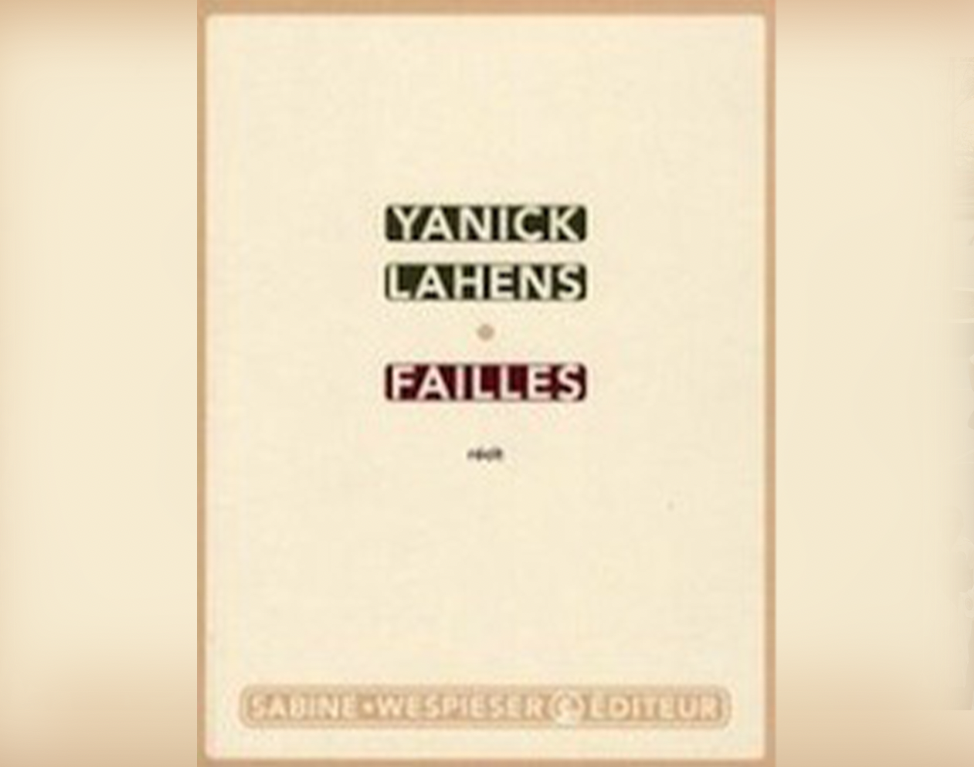Difficile de remonter ce temps d’angoisse, de pleurs et d’afflictions qu’a connu Haïti à l’aube de l’année 2010, où s’annonçaient espoirs et attentes des jours rayonnants. Le 12 janvier à 16 heures 53 minutes, la terre d’Haïti chevauchait dans tous les sens, faisant près de 280 mille morts et un nombre considérable de blessés. Cet événement tragique plongea le pays dans un marasme sans appel.
Dans ce giron de détresse, la littérature, mémoire de l’existence, lève sa voix pour prendre la mesure de ce malheur. Des auteurs établis de la scène littéraire haïtienne ont exprimé leur indignation et l’amertume provoquée par cette catastrophe en produisant des œuvres d’anthologie. Dans ce concert d’auteurs, se distingue Yanick Lahens. Figure notoire de la littérature francophone et voix majeure de la littérature haïtienne contemporaine. Elle est l’auteure d’une œuvre plurielle qui reflète les déboires et les heurts d’une société en Mad max de toutes pièces. Alors que Port-au-Prince vivait sous les décombres, elle fait paraitre en 2010 chez Sabine Wespiezer Failles. Récit fulgurant qui livre sans parcimonie les impressions et les confidences de l’auteure sur ce séisme meurtrier qui a frappé Haïti.
Ce texte poignant est l’occasion pour l’auteure de faire voir l’événement sous un prisme différent. Port-au-Prince est décrite comme une femme éreintée par les dieux qui se repaissent de chair et de sang. La ville s’écroule cheveux hirsutes, yeux révulsés, jambes disloquées, sexe béant, exhibant ses entrailles de ferraille et de poussière, ses viscères et son sang. Par cette image frappante et saisissante, embryonnaire a la culture haïtienne, Lahens peint l’événement dans toute sa démesure et sa témérité qui a emporté jusque dans les entrailles les plus profonds, les souvenirs, les mystères et la vigueur de cette ville dans l’indicibilité du temps.
L’auteure esquisse avec modération les retombées de cet événement macabre qu’elle aura vécu : des corps jonchés sur le sol, des bâtiments effondrés, des vies et des mourants sous les décombres et les gravats de Port-au-Prince, des corps mutilés de toutes sortes et des morts qui s’alourdissent à la rigueur du temps. Naviguée par cet océan de malheurs et des survivants atterrés par le spectre de ce mal endolori, Lahens impose l’écriture, par ricochet, la littérature, comme instrument d’exploration de la mesure du malheur et de briser le rythme du silence dévorant de l’événement.
« Cette terre des mots, la seule qui soit notre, a nous écrivains, se fissure et risque de craquer elle aussi si nous n’y prenons garde. » P.18
La singularité de l’œuvre tient à la transcendance fulgurante de l’auteur à pouvoir regarder l’autre face de cette mésaventure. Si le titre du texte ne semble revêtir une signification littéraire, c’est pour dessiller les yeux et les pensées des lecteurs sur l’essentialité du problème, à savoir les failles qui ont conditionné cet instant ensanglanté et mystérieux. Lahens s’est tenue à son courage, vertu cardinale, pour dénoncer le dilettantisme des responsables et des acteurs de la chose publique. Ces failles qui constituent le nœud gordien de l’effondrement de la ville, de surcroit le pays.
« Quelques un d’entre nous ont lu l’année dernière les rapports inquiétants sur la faille d’Enriquillo qui traverse le sud de toute l’ile, de la pointe ouest de Tiburon en Haïti jusqu’à la ville de Santo Domingo en République dominicaine… Mais, rien ne bougeant en dessous de nous, la grande majorité a choisi le déni. » p. 32
Yanick Lahens lève les voiles sur le laxisme des dirigeants du pays qui n’ont guère porté leurs regards sur le drame qui se dessinait. Ils ont dénié, pour la plupart, l’imminence de la mort de toute une ville. Ce déni ne coïncide pas seulement à la réalité géologique, il s’apparent également à toutes les couches conséquentes du pays. Les failles dont parle l’auteur représentent les ingérences de toutes sortes, tant politiques, économiques et sociales du pays. De plus, l’aide internationale et les ONG qui font de la terre d’Haïti un lieu de choix et de privilège, n’ont pas réussi à apporter des changements significatifs à un pays accablé et balloté de mille manières par les crises politiques, les dégâts causés par les revers de la nature et les altérités alarmantes de la société.
« Nous feignons de les ignorer alors qu’ils constituent des failles mortifères, alors qu’ils sont des lignes structurelles tout aussi meurtrières que les séismes. » P.32
15 ans plus tard, les mêmes failles semblent à l’ordre du jour. Les mêmes situations persistent. Le mal n’est pas enrayé. Il se dégénère. Les failles sont plus profondes. L’urgence d’agir est indispensable. Les plaies se puent. Les besoins primaires sont précaires. L’existence est utopique. La ville est livrée, déshabillée et mise à nue par la brutalité du pire. Ne vivons-nous pas, 15 ans plus tard, un séisme de plus grande envergure et de plus cataclysmique ? Ne sommes-nous pas toujours au gibet du malheur ? Le malheur nous permet-il de prendre la mesure de notre condition?
Ces questions doivent alimenter les discussions du quotidien politique et idéologique du pays. Elles doivent rendre lucide les actions du collectif. Aussi, Yanick Lahens, nous fait comprendre que le séisme, en filigrane, ne doit pas être perçu comme un hasard naturel, mais le produit de l’inaction des responsables et de tout un système léthargique face aux grands chantiers de l’édifice national.
A travers le Failles, récit intemporel, Lahens tente d’alerter Haïti, de l’imminence d’un double danger. D’abord, les catastrophes sont une évidence qui ne demande bien plus que des propagandes puériles et obsolètes. Ensuite, les failles du système politique, économique et social doivent être creusées. Au risque de ne pas encourir des maux plus meurtriers, tel qu’ils le sont aujourd’hui.
Jameson Christanval
Christanvalsongmail.com